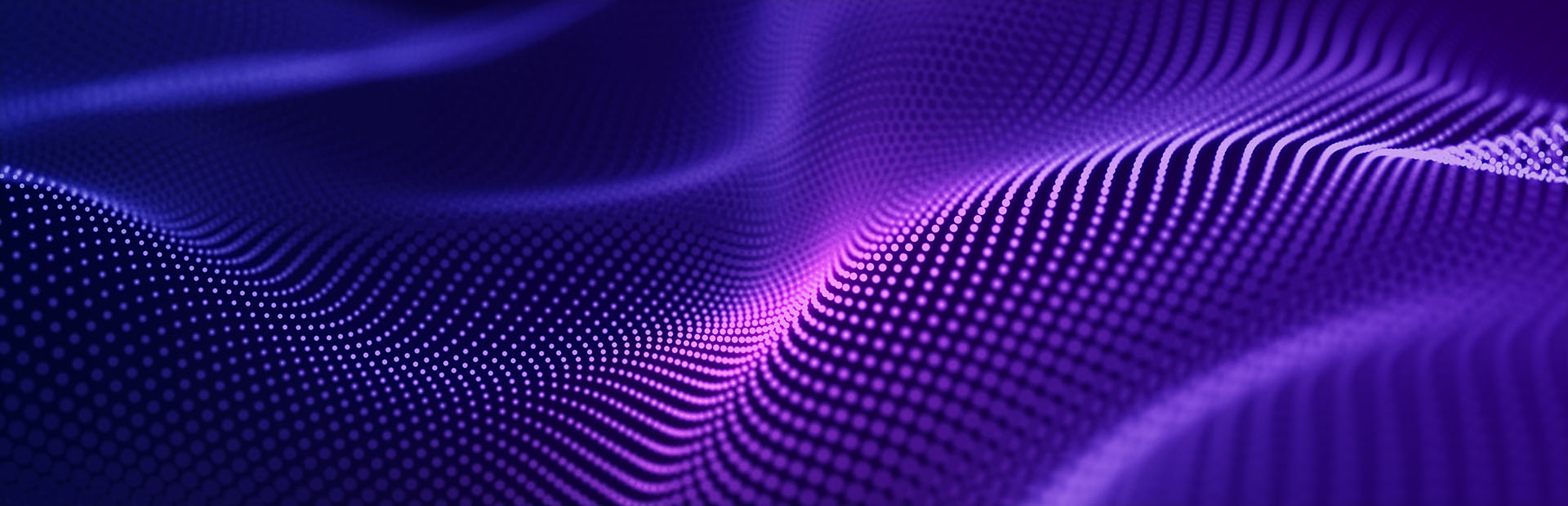M. Soros était-il un initié secondaire selon le droit pénal français de 1988 ?

Auteurs
Voilà une affaire singulière à bien des égards : des faits anciens (1988) qui commandent une application rigoureuse de la lettre mais aussi de l’esprit des textes de l’époque ; un requérant médiatique, investisseur averti, féru de bons coups boursiers ; et une norme pénale française dont l’interprétation divise jusqu’aux juges communautaires entre eux, une opinion séparée étant annexée à la décision de la CEDH du 6 octobre 2011 Soros c/ France.
Aux faits de l’espèce, le requérant, M. Soros, avait fait acquérir par son fonds d’investissement, sur le marché londonien et le marché parisien, un nombre significatif d’actions d’une banque française alors même qu’il avait été informé par un groupe d’investisseurs du projet de prise de contrôle de cette banque par ces derniers en vue d’y participer. Avant révélation au public de cette information privilégiée, il avait revendu en plusieurs opérations ces titres dégageant à cette occasion un profit de 1,1 millions de dollars sur le seul marché français.
Après enquête, la Commission des opérations de bourse considéra en 1989 que « en l’absence d’une règle écrite, d’un usage reconnu en jurisprudence ou d’une déontologie admise par la profession, dont la violation aurait été établie, le faisceau d’éléments apportés par l’enquête ne lui permettait pas, au cas d’espèce, de tracer avec certitude entre le licite et l’illicite ». Au résultat, l’ordonnance de 1967(1) étant sur ce point trop imprécise. Le rapport d’enquête ayant été transmis au Parquet, la procédure pénale engagée aboutit à des condamnations pécuniaires pour délit d’initié à raison de l’acquisition de titres sur le marché français.
Sur le fond, dès la première instance, le requérant avait (en vain) soulevé l’exception d’illégalité de la poursuite tirée de l’imprévisibilité de la loi relative au délit d’initié (« personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leur fonctions, d’informations privilégiées » […]). Il faisait valoir que les termes de l’ordonnance de 1967 exigeait que l’initié ait entretenu des relations professionnelles avec la cibl (ici la banque française), condition qui n’était pas satisfaite au cas d’espèce. En outre, il invoquait le caractère imprécis du projet de prise de contrôle et l’ignorance dans laquelle il se trouvait du caractère confidentiel de l’opération.
A l’inverse, les juridictions pénales françaises ont estimé qu’il suffisait que l’initié ait obtenu l’information dans le cadre de sa profession ou de ses fonctions, sans nécessairement qu’il ait été en relation professionnelle avec la cible, pour que l’infraction soit constituée.
Sur les deux griefs précités, la CEDH estime que d’une part, la loi applicable à l’époque des faits était « suffisamment prévisible » pour permettre au requérant de se douter que sa responsabilité pénale était susceptible d’être engagée et, d’autre part, en conséquence de cette prévisibilité suffisante, le grief tiré de la précision de la directive postérieure de 1989, à supposer qu’elle fut favorable au requérant, ne pouvait être retenu dès lors que la législation nationale était en elle-même suffisamment prévisible. Ce second moyen, non examiné par la Cour, était à notre avis voué à l’échec, le champ de cette directive (d’harmonisation minimale a fortiori) étant limité aux seules infractions administratives.
La décision rendue par la Cour à une courte majorité (4 voix contre 3) n’emporte pas notre conviction. Non pas que les faits particulièrement probants ne conduisent pas à considérer que le comportement du requérant constituait, en fait, ce qu’il communément entendu par « opération d’initié ». Mais s’agissant du droit pénal des affaires, cette décision heurte plusieurs principes.
Le principe de légalité commande que la loi pénale soit rédigée en des termes suffisamment précis pour que les sujets de droits puissent adapter leurs comportements en conséquence. Qu’il naisse une difficulté (raisonnable) d’interprétation et une interprétation stricte des termes de cette loi devra alors prévaloir, et ce au bénéfice du mis en cause. Ici, un sujet de droit pouvait-il aidé de conseils considérer avec une certitude suffisante que son comportement était répréhensible ? Une réponse négative aurait dû s’imposer à la Cour au moins pour plusieurs raisons :
A l’époque des faits, les seules condamnations prononcées en France sur ce fondement concernaient des personnes qui avaient un lien avec la société émettrice (lien de nature professionnelle et, le cas échéant, contractuelle). Le doute sur le champ d’application exact de la norme aurait dû être considéré comme légitime.
L’avis consultatif émis par la COB dans cette affaire, s’il a un caractère individuel, n’en comporte pas moins une affirmation d’ordre général sur le caractère lacunaire du droit français de l’époque. Que cet avis soit consultatif et que la procédure pénale soit indépendante et servie par une enquête approfondie n’ôtent rien à la force de cette affirmation.
Le rapport sur la déontologie boursière du 10 janvier 1990 - quand bien même n’aurait-il pas un lien de causalité direct avec l’avis de la COB dans cette affaire - démontre par sa chronologie et les clarifications apportées que la règle française était particulièrement (trop) imprécise.
1. Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, art. 10-1.
Par Bruno Zabala, Avocat
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 31 octobre 2011