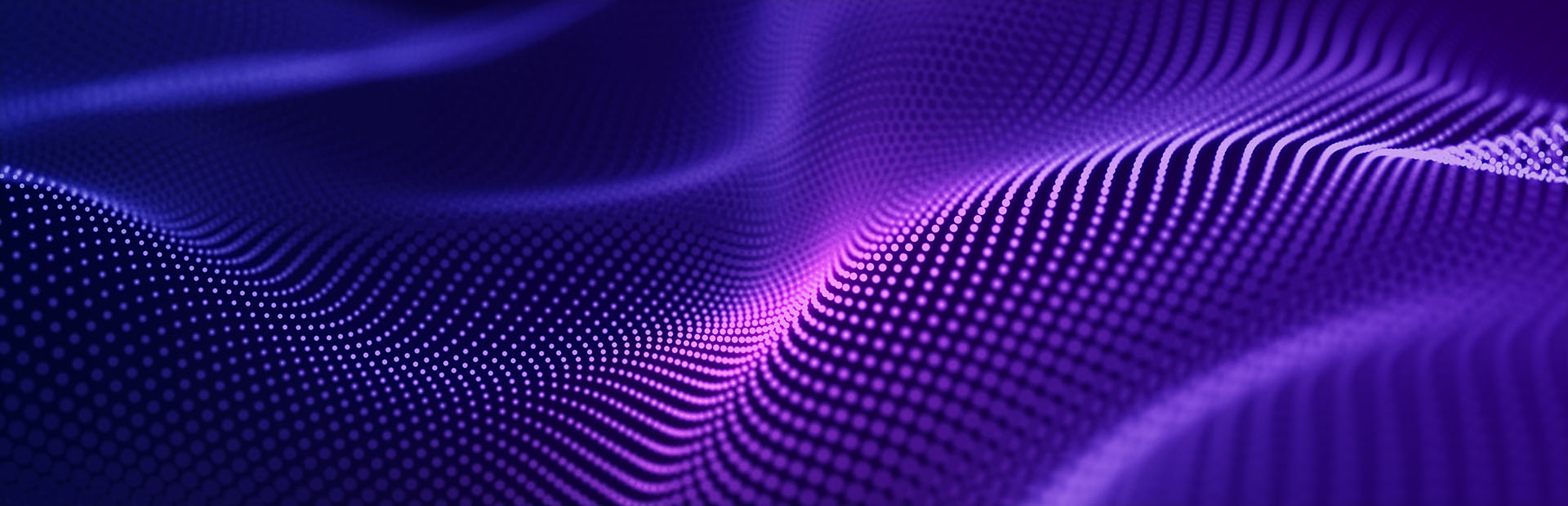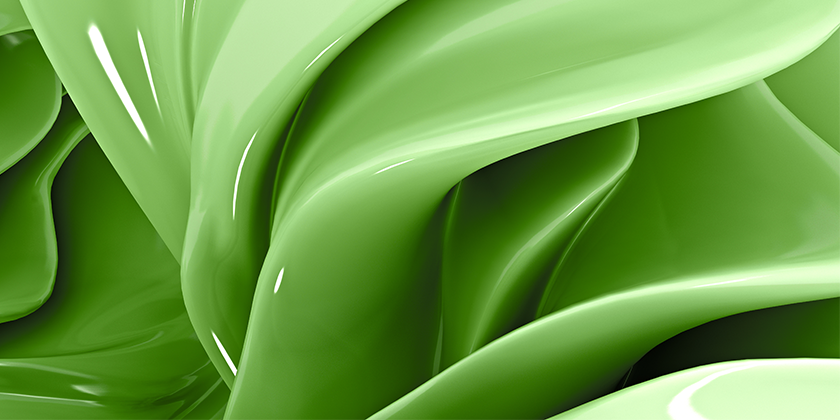Regard critique d'un praticien sur le projet de loi relatif aux contrats de partenariats

On sait que les contrats de partenariat présentent un caractère subsidiaire : leurs conditions d'utilisation sont encadrées, conformément à la réserve d'interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi d'habilitation sur le fondement de laquelle l'ordonnance du17 juin 2004 a été adoptée (Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC). Prenant en compte les exigences formulées par le Conseil constitutionnel, l'ordonnance impose une évaluation préalable et n'autorise le recours au contrat de partenariat que si, notamment, l'évaluation démontre soit la complexité technique ou juridique et financière du projet, soit son urgence. Cette contrainte a priori,fondée sur des critères d'ordre formel,a pu être critiquée. Pour la desserrer, le projet de loi (art. 2 et 16) procède de deux manières : d'une part, en ajoutant une troisième voie d'accès (souvent désignée sous le terme de « troisième critère »), d'autre part en ouvrant la possibilité de recourir au contrat de partenariat dans un certain nombre de secteurs prioritaires,en présumant rempli le critère d'urgence.
L'utilisation
du « troisième critère » suppose de démontrer l'efficience du contrat
de partenariat. Il est formulé de la façon suivante : « compte tenu
soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service
public dont la personne publique est chargée et des contraintes qui
pèsent sur celle-ci, soit des insuffisances et difficultés observées
dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat
présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus
favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique ». L'ajout
de cette voie d'accès est le bienvenu, car l'intérêt du recours au
contrat de partenariat peut ne pas être lié au caractère complexe d'une
situation (notamment lorsque le recours au contrat aura fait ses
preuves pour un certain type de projets... qui n'auraient alors plus
rien de complexe !).
Le critère d'urgence est en outre reformulé. La mention d'un retard
particulièrement grave à rattraper, affectant la réalisation
d'équipements collectifs, figure désormais expressément dans le texte
(il s'agissait d'une réserve d'interprétation posée par le Conseil
d'État : CE, 29 oct. 2004, n° 269814, Sueur : Rec. CE 2004, p. 393,
concl.D. Casas). L'hypothèse d'une situation imprévue est ajoutée : par
a contrario, le retard à rattraper peut donc ne pas avoir été imprévu.
Surtout, le projet de loi, parfois par renvoi aux textes sectoriels
antérieurs, présume urgent, jusqu'au 31 décembre 2012, certains besoins
relatifs, soit à l'enseignement et la recherche, soit à la police, à la
gendarmerie nationale, aux armées et aux services du ministère de la
Défense, soit à la santé, soit encore « aux infrastructures de
transport s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la
rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite et à l'amélioration de l'efficacité
énergétique des bâtiments publics ». Pour les collectivités
territoriales, seuls sont éligibles ce dernier groupe d'activité et
les projets répondant aux nécessités de la réorganisation des
implantations du ministère de la Défense.On peut s'étonner de cette
restriction alors que,d'une part, les collectivités territoriales sont à
la source de la très grande majorité des investissements publics en
France,d'autre part, sur le fondement des dispositions de la loi du 29
août 2002 d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure
(LOPSI), les collectivités territoriales ont réalisé, et de très
loin, le plus grand nombre d'opérations de « PPP » (notamment sous la
forme des baux emphytéotiques administratifs « Gendarmerie » ; ce dispositif
a pris fin le 31 décembre 2007, sous réserve de la prolongation
pour les procédures en cours permise par la loi de finances 2008,
n° 2007-1822, 24 déc. 2007, art. 119 : JO27 déc. 2007,p. 21211).
La possibilité de passer en délégationde service public (DSP), si à
l'issue du dialogue compétitif il apparaissait que ce dispositif était
plus approprié que le contrat de partenariat pour l'opération
concernée, avait été envisagée dans la première mouture de l'avant
projet de loi. Cette option procédurale ne figure plus dans le projet
de loi. Elle pouvait trouver une certaine forme de légitimité dans
l'incertitude qui entoure la notion de DSP, mais également dans le
fait que, selon la Commission européenne, l'un des éléments de « complexité juridique et financière
», qui peut justifier le recours au dialogue compétitif, est justement
l'incertitude sur le degré de transfert du risque économique pouvant
faire hésiter entre le marché et la concession (V. fiche explicative
sur le dialogue compétitif : Doc. CC/2005/04/FR, 17 janv. 2006). La
difficulté, entre autres, de définir un « programme fonctionnel » qui puisse évoluer d'un
contrat de partenariat vers une DSP, sans recommencer intégralement la procédure, peut expliquer cet abandon.
Pour autant, l'impossibilité, majoritairement admise, de confier au
titulaire la gestionmême du service public n'est-il pas « un verrou à
faire sauter » ? (F. LLorens, Un verrou à faire sauter : JCP G 2007, « numéro historique
», Hors série, cah. 2, p. 56). Pour certains ouvrages dont
l'exploitation technique se confond avec la gestion même du service
public - routes, ou usines de traitement des déchets, par exemple - la
situation est incertaine (Cf. Rép. min.
n° 22017 : JO Sénat Q 18 mai
2006, p. 1385, M. B. Piras). Selon un auteur, la précision apportée par
le projet de loi (art. 1er et 15), permettant au cocontractant de
bénéficier d'un mandat pour encaisser, au nom et pour le compte de la
personne publique, le paiement par l'usager final de prestations
revenant à cette dernière, pourrait impliquer que la gestion même du
service public puisse être confiée au titulaire d'un contrat de
partenariat (F.Lichère,Le projet de loi sur les contrats de partenariat
: vers l'extension et la clarification du partenariat public privé
:AJDA2008,p. 123). Une clarification paraît cependant indispensable car
on ne saurait s'en tenir à de tels indices.
En attendant, on relèvera la nécessité d'une disposition
législative pour permettre lemandat de perception de recettes, plus
souple que celui de la régie de recettes, et ce conformément à un avis
récent du Conseil d'État (CE, avis,13 févr. 2007, circ.min. intérieur,
n° INT/B/08/00027/C, 8 févr. 2008, Conventions de mandat passées par
des collectivités et établissements publics locaux.- Sur ces questions,
D. Moreau, Le régime des recettes dans les contrats publics : AJDA
2007, p. 1513).
Actuellement, l'article 11 d) de l'ordonnance - codifié à l'article L.
1414-12 d) du Code général des collectivités territoriales pour ces
dernières - prévoit que le cocontractant peut être autorisé à tirer des
recettes d'exploitation des équipements, à d'autres fins que la
satisfaction des besoins de la collectivité publique (par ex. : espaces
annexes d'un stade, location des salles d'un musée, etc.). L'intérêt
est évidemment que le paiement effectué par la personne publique pour
l'utilisation de l'ouvrage s'en trouve d'autant diminué.
Le projet de loi (art. 9 et 23),par souci sans doutede
clarification, ajoute la possibilité de percevoir des recettes
d'exploitation du domaine. Les ressources intégrées dans la
rémunération du cocontractant peuvent donc provenir non seulement de
l'équipement public, mais également du domaine public ou
privé.Cependant, plutôt que d'exploitation, il aurait été préférable,
comme le fait par ailleurs le projet de loi (art. 11 et 25), d'utiliser
le terme de « valorisation ». Des valorisations sous forme de
cessions sont tout à fait possibles, lorsqu'elles portent sur le
domaine privé. Les personnes publiques disposent en effet à cet égard
de la liberté de gestion de leur domaine privé (CGPPP, art. L.
2221-1).On pourrait également regretter que l'occasion ne soit pas
saisie d'étendre aux collectivités territoriales le dispositif de
souplesse pour la cession de biens affectés temporairement au service
public, existant pour l'État et ses établissements publics (CGPPP, art.
L. 2141-2).
En revanche, on ne peut qu'approuver la possibilité ouverte au
titulaire du contrat de consentir des baux dans les conditions du droit
privé, notamment des baux à construction ou des baux emphytéotiques,
pour les biens qui appartiennent au domaine privé, sous réserve de
l'accord de la personne publique.En effet, la conclusion de ces deux
derniers types de baux suppose normalement que le bailleur dispose de
la propriété pleine et entière, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
Cette dérogation législative est donc la bienvenue ; elle est même
indispensable pour certains types d'investisseurs tels que les sociétés
immobilières d'investissement cotées (SIIC). On peut en revanche
souhaiter que la possibilité de conclure de tels baux ne soit pas
limitée à la durée du contrat de partenariat.
L'ordonnance du 17 juin 2004 a introduit dans le Code monétaire et financieruntype particulierde cessionde créances « Dailly » (CMF, art. L. 313-29-1). Mais, la pratique s'en est parfois détournée, au bénéfice de la cession Dailly acceptée « classique » (CMF, art. L. 313-29). De fait, le recours à la cession Dailly spécifique « est une faculté. Reste ouverte la possibilité de toute autre forme de cession. » (A. Ménéménis, L'ordonnance sur les contrats de
partenariat : heureuse innovation ou occasion manquée : AJDA2004, p. 1737). L'explication est la suivante.
D'une part, dans une cession de créance « acceptée » de droit
commun, la cession et l'acceptation, fondement de l'inopposabilité des
exceptions, reposent sur un dispositif - acte d'acceptation, voire
convention tripartite - autonome du contrat principal. Pour les
cessions « PPP », on pouvait craindre que le caractère acquis
de la créance ne tombe dès lors qu'il trouvait son fondement dans le
contrat de partenariat lui-même. Le projet de loi (art. 29) propose
que
le cessionnaire soit expressément garanti du paiement de la
créance,même en cas d'annulation du contrat ou de fin anticipée.
D'autre part, dans le cas d'une cession « PPP », le montant cessible est limité à une « fraction du coût des investissements
», alors qu'une cession acceptée, de type cession-escompte, peut porter
sur tout ou partie d'un flux constant et global (capital et intérêts).
Le projet de loi précise certes que les coûts d'investissement
comprennent notamment les coûts d'études et de conception, les coûts
annexes à la construction et les frais financiers intercalaires (ce que
la
pratique désigne sous le terme d' « assiette de financement »).Mais, en l'état,on peut penser que la cession « PPP » restera concurrencée par la cession Dailly acceptée « classique
», à laquelle est attaché un taux de marge bancaire très favorable. En
pratique, cela n'est cependant guère gênant dès lors que l'acceptation
d'une cession de créance peut être conditionnelle.
La réalisation des premières opérations de PPP a montré que les mesures
prises par l'ordonnance - concernant la taxe foncière et le fonds de
compensation de la TVA- pour neutraliser le biais fiscal en faveur
d'une solution de maîtrise d'ouvrage publique, étaient insuffisantes.
S'agissant de la fiscalité de l'urbanisme, le projet de loi (art. 26 et
27) procède dès lors à un certain nombre de correctifs, qui concernent
le versement pour dépassement du plafond légal de densité (C. urb.,
art. L. 112-2, mod.) et la redevance pour création de bureaux ou de
locaux de recherche en région Ile-de-France (C. urb., art. L. 520-7,
mod.). Les autres modifications nécessaires, d'ordre réglementaire,
donneront lieu à l'adoption d'un décret (cas de la taxe locale
d'équipement et des taxes additionnelles).
En matière de taxe de publicité foncière (art. 26), un"droit fixe"
(de 125 Euro actuellement) serait institué pour la publication du
contrat de partenariat et des contrats assimilés (AOT-LOA, BEA
/BEH...). Le crédit-bail éventuellement conclu par le titulaire du
contrat de partenariat en bénéficierait également. Par ailleurs,
corrélativement, un décret devrait traiter du salaire du conservateur
des hypothèques, cette question étant de nature réglementaire.
L'article 14 du projet de loi prévoit que les projets réalisés en
contrat de partenariat sont éligibles aux mêmes subventions que ceux
réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique. Il existe un précédent
récent à ce dispositif de neutralisation dans la « loi sur l'eau », ajoutant un article L. 2224-11-5 au Code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau
potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service public
» (L. n° 2006-1772, 30 déc. 2006, art. 54, venant infirmer : CE, 12
déc. 2003, n° 236442, Dpt des Landes : JurisData n° 2003-066168).
Au-delà des subventions des collectivités publiques (État, département,
région...), les contributions que certains opérateurs sont parfois
amenés à allouer dans le cadre d'investissements publics - EDF par
exemple - nous paraissent également visées
Parmi les clauses obligatoires que doit comporter un contrat de
partenariat, l'ordonnance prévoit l'obligation pour le titulaire de
constituer une caution en faveur des entrepreneurs réalisant les
travaux, pour leur en garantir le paiement. Le projet de loi (art. 9)
substitue le terme de « prestataire » à celui, impropre, de « soustraitant » : le titulaire est en effet « maître d'ouvrage » au sens de la loi du 31 décembre 1975 et ses cocontractants sont donc des
« entrepreneurs principaux
». On peut en revanche regretter que cetteobligationde garantie,posée
de façon générale, soit maintenue et même élargie aux prestations de
conception et à la livraison de « fournitures spécifiques » (s'agit-il exclusivement des « EPERS » visés à C. civ., art. 1792-4 ?).
Cette obligation, dont on croit comprendre qu'elle vise à protéger
les « petits » sous-contractants nous semble manquer son objectif,
compte tenu des schémas juridiques généralement utilisés. D'une part,
il est en effet fréquent que le cocontractant de premier rang du
titulaire du contrat de partenariat soit un « ensemblier »
appartenant àungrandgroupe(aux termes d'un contrat de promotion
immobilière pour la phase travaux). D'autre part, il arrive que le
titulaire ne soit pas une société de projet,mais un investisseur, et
particulièrement un établissement financier. Exiger une garantie
bancaire, ou des délais de paiement spécifiques, dans ces hypothèses,
ne présente pas d'intérêt et surenchérit donc inutilement le coût des
contrats de partenariat.
Article paru dans La Semaine Juridique - Edition Administrations et Collectivités Territoriales n°10-11 - 3 mars 2008
Authors:
François Tenailleau, Avocat