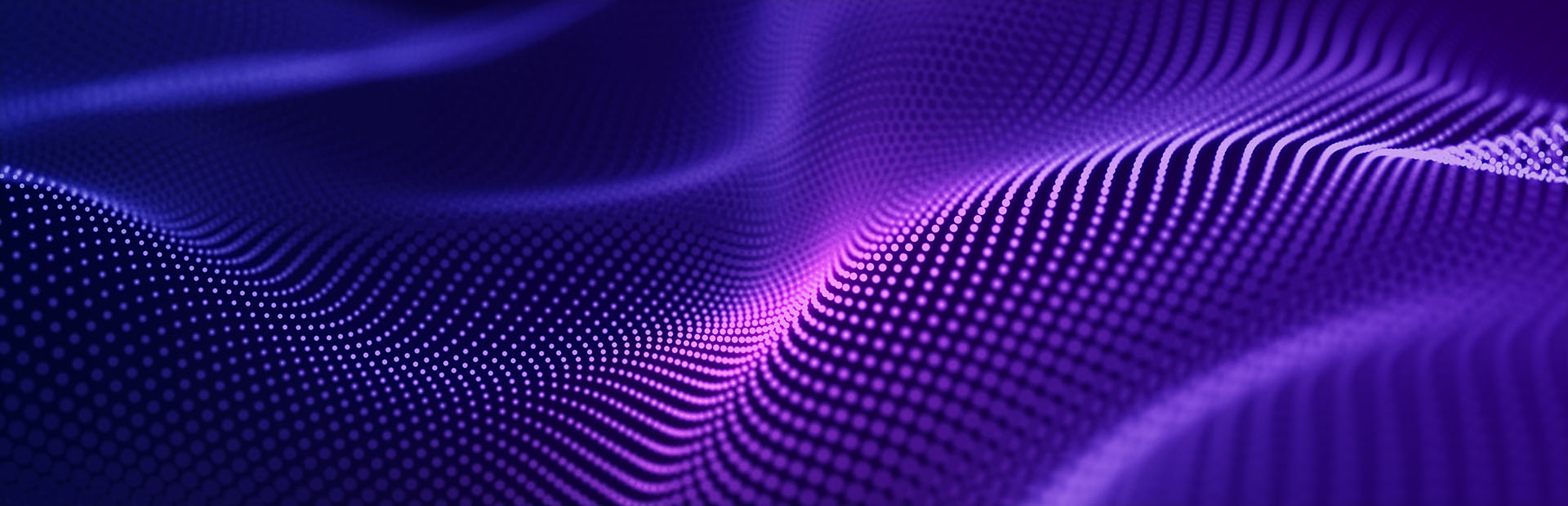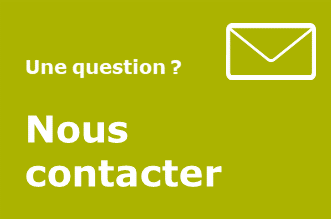A l’heure où se multiplient les annonces des entreprises autour de leur stratégie de développement durable visant la neutralité carbone à échéance plus ou moins brève, la compensation volontaire, qui est l’un des instruments permettant d’atteindre cette neutralité, se développe.
La neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de carbone et l’absorption du carbone de l’atmosphère par les puits de carbone. Concrètement, une entreprise peut explorer trois axes pour contribuer à la neutralité carbone : identifier et mener des actions pour éviter certaines de ses émissions de gaz à effet de serre, déployer des actions qui contribuent à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre ou, enfin, compenser des émissions de gaz à effet de serre par des actions de réduction indépendantes de ses activités. L’ADEME précise que « la compensation volontaire consiste (…) à financer un projet de réduction ou de séquestration d’émissions de GES dont on n’est pas directement responsable ». C’est sur ce troisième axe que se déploie le marché de la compensation volontaire, à côté du marché carbone réglementé avec lequel il peut – mais ce n’est pas systématique – communiquer.
Si le marché carbone réglementé est finalement le résultat d’un mécanisme économique et juridique encadré très tôt par les autorités internationales et nationales, le marché de la compensation volontaire est né plus récemment, en dehors de toute obligation. Il s'est structuré autour de la volonté de ses participants mais ne représente actuellement qu’un faible volume de transactions.
Jusqu’à quel point les qualifications posées pour le marché réglementé sont-elles transposables au marché volontaire ? Le droit est actuellement en train de s’écrire. Le marché des unités "carbone" volontaires se structure classiquement, comme tout marché, autour de deux marchés, le marché primaire et le marché secondaire, les entités souhaitant mettre en place une démarche de compensation pouvant s’adresser indifféremment à un acteur du marché primaire (les porteurs de projet) ou du marché secondaire (un intermédiaire). Des questions aussi fondamentales que celles de la nature juridique des unités "carbone" cédées sur le marché volontaire, de leur certification, de l’identification de l’instant où nait l’objet juridique susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété et de l’identification du patrimoine juridique dans lequel cet objet juridique nait ab initio ne reçoivent pas toujours une réponse bien établie. Il apparaît que comme les quotas CO2 par l’effet de l’article L.229-11 du code de l’environnement et les unités Kyoto par l’effet des articles L.229-22, L.229-24, L.229-24-1 du même code, les unités "carbone" sont des biens meubles incorporels matérialisés par leur inscription au compte de leur détenteur, librement cessibles, figurant dans le patrimoine juridique de leur titulaire qui va pouvoir les valoriser au titre de sa RSE. Comme on le devine, les interrogations juridiques et fiscales qui naissent lors de la mise en œuvre d’une démarche de compensation volontaire sont multiples et peuvent décontenancer les opérateurs. Le regain d’intérêt ressenti actuellement pour la compensation volontaire devrait contribuer au défrichement juridique et fiscal du mécanisme.
A la différence des quotas d'émission de CO2 mentionnés à l'article L. 229-7 du Code de l'environnement, les unités "carbone" ne peuvent être rattachées à aucun des sous-jacents figurant à l'article D. 211-1 A du Code monétaire et financier, qui dresse la liste des instruments financiers à terme. Autrement dit, il n'est pas encore possible de conclure des swaps, forwards ou options portant sur des unités "carbone" volontaires. Le recours aux instruments financiers à terme pourrait être d'une grande utilité pour renforcer la fluidité de ce marché et pour se couvrir contre les risques de volatilité du marché ou de pénurie des unités "carbone". Une modification du Code monétaire et financier admettant les unités "carbone" comme sous-jacent autorisé d'un instrument financier à terme serait donc la bienvenue.
Article paru dans Option Finance le 14/06/2021
Le droit de l'énergie au sein de notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats dispose d’une équipe parmi les plus reconnues en matière de droit de l’énergie qui conseille les acteurs du secteur de l’énergie sur toute la chaîne de valeur. Notre cabinet d'avocats vous propose une approche qui repose sur une compréhension avérée de ce secteur d’activité et sur la pluridisciplinarité de notre équipe constituée d’une quinzaine de spécialistes travaillant en étroite collaboration avec nos avocats basés en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.