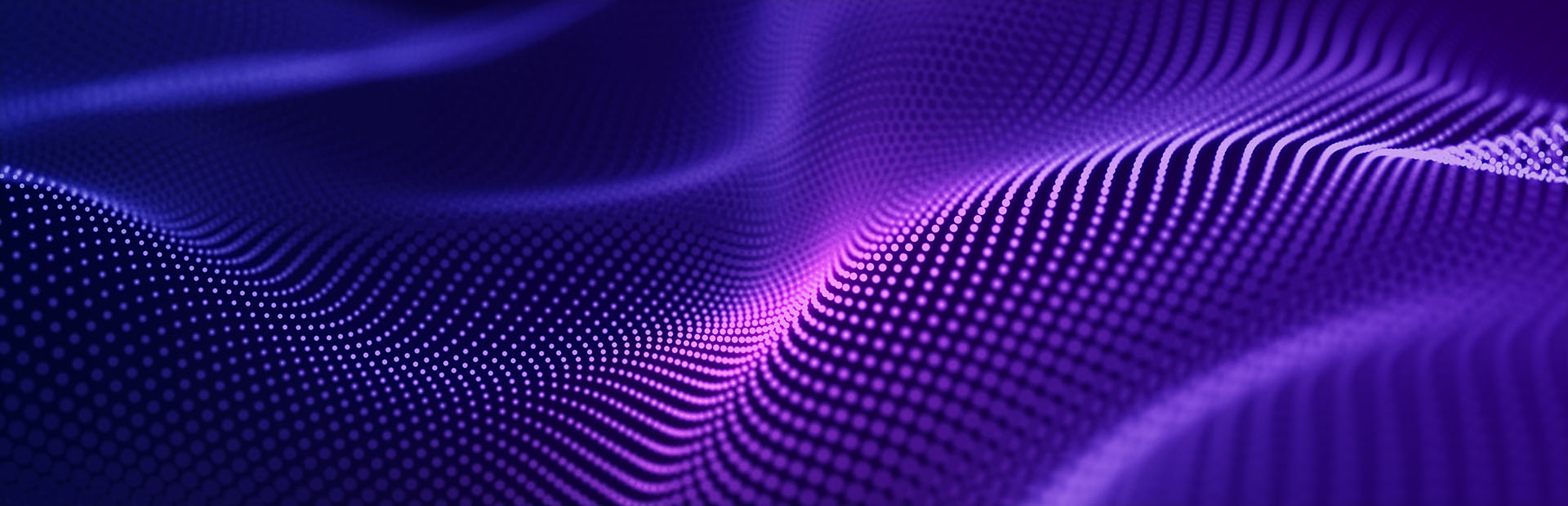Chronique de droit pénal du travail

L'arrêt rendu le 20 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation 1
apporte, comme on le verra plus loin, divers enseignements sur les
éléments constitutifs des infractions de travail illégal, mais il
intéresse d'abord la recherche des responsables, ce en quoi il mérite
de figurer dans cette première partie.
En l'espèce, les salariés d'un groupe économiquement intégré, dont
l'activité se répartissait entre trois sociétés, étaient affectés tour
à tour, par un unique chef d'exploitation, aux tâches exécutées pour le
compte de l'une ou l'autre de ces personnes morales.
A la suite d'un banal accident de la circulation qui impliquait
l'un de ses véhicules, le dirigeant commun aux sociétés fût mis en
cause pour travail dissimulé alors que l'une des trois entités l'était
simultanément pour marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre à but
lucratif.
Ainsi, personne physique et personne morale faisaient l'objet de
poursuites cumulées, non pas pour les mêmes infractions, mais à raison
de qualifications différentes appliquées à une même situation de fait,
la personne physique ayant en outre agi comme organe de la seconde pour
ce qui était reproché à celle-ci, conformément aux exigences de
l'article 121-2 du Code pénal.
On observera tout d'abord que cette répartition des poursuites
entre les deux types de responsables pénaux visés par la loi constitue
une prérogative du ministère public que celui-ci exerce
discrétionnairement sans qu'on puisse en aucune façon y porter
critique. Sur ce point capital, les parquets devraient néanmoins à
l'avenir s'inspirer des solutions préconisées par la circulaire du 13
février 2006 prise pour l'application de la loi du 9 mars 2004
généralisant la responsabilité pénale des personnes morales.
En effet, aux termes de cette circulaire, il est demandé aux
procureurs, lorsqu'il s'agit d'infractions intentionnelles, de procéder
à un cumul des poursuites entre personnes physiques et personnes
morales, alors qu'ils sont dissuadés de le faire à propos des
infractions non intentionnelles.
S'agissant de ce deuxième ensemble d'infractions en effet, il est
demandé aux parquets de privilégier les poursuites contre la seule
personne morale, la mise en cause de la personne physique ne devant
intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son
encontre pour justifier une condamnation pénale.
Mais en raison de la théorie propre à chaque infraction, cette
distinction, qui fait figure de summa divisio, n'est simple qu'en
apparence et la ventilation des infractions entre les deux catégories
ainsi créées peut s'avérer délicate.
En particulier, puisque tel est notre propos, à quelle catégorie
rattacher le délit de travail dissimulé et plus généralement les
différentes incriminations du travail illégal ? Celles-ci ne sont-elles
pas présentées d'ordinaire comme des infractions de nature
intentionnelle 2 ?
Si tel était le cas, il conviendrait alors, par application de la
circulaire, que le ministère public opte pour des poursuites cumulées
entre personne physique et personne morale, susceptibles de déboucher
sur une double déclaration de responsabilité pénale, ce qui, on
l'observera, ne correspond pas à la répartition des poursuites opérée
par le parquet dans l'affaire commentée.
En vérité, cette orientation ne va pas de soi car, aux termes mêmes
de la circulaire précitée, l'option contraire c'est-à-dire le non-cumul
des poursuites et la recherche prioritaire de la responsabilité pénale
de la personne morale intéresse non seulement les infractions non
intentionnelles caractérisées par une faute d'imprudence, mais
également « les infractions de nature technique pour lesquelles
l'intention coupable peut résulter, conformément à la jurisprudence
traditionnelle de la Cour de cassation, de la simple inobservation en
connaissance de cause, d'une réglementation particulière » 3.
Une prise en compte des directives ministérielles ci-avant
rappelées aurait donc dû conduire à orienter les poursuites pour
travail dissimulé vers la personne morale et elle seule, car il s'agit
en l'occurrence d'une « infraction de nature technique ».
En douterait-on, qu'un indice fort de ce qu'il y a lieu d'appliquer
à cette infraction les mêmes solutions qu'aux infractions d'imprudence,
pourrait être trouvé dans la réponse de la chambre criminelle
lorsqu'elle approuve les juges du fond d'être entrés en voie de
condamnation.
La Haute Juridiction relève en effet qu'il résulte des motifs de la cour d'appel que le « prévenu n'a pas délégué les pouvoirs attachés à ses fonctions de direction
», ce qui situe implicitement le délit de travail dissimulé dans le
champ des règles propres à la responsabilité des décideurs, laquelle
est caractérisée par une imputation initiale de l'infraction au chef
d'entreprise puis par une descente éventuelle de celle-ci vers un
délégataire, ou un subdélégataire, dès lors que les conditions de
validité pénale de la délégation sont réunies. Or, ce système
d'imputabilité original ne peut fonctionner que pour les infractions
dont l'élément moral tolère qu'on ait à répondre du comportement
matériel d'autrui, la violation d'obligations de sécurité avec ou sans
préjudice corporel restant à cet égard l'exemple topique.
En revanche, lorsque l'incrimination requiert la démonstration du
fait personnel de l'agent, on ne saurait reprocher au chef d'entreprise
d'avoir laissé commettre, même faute de délégation, l'infraction
correspondante dont il peut ne pas avoir eu connaissance et,
inversement, si, en connaissance de cause, il a pris part à la
consommation de l'infraction intentionnelle, aucune délégation, même
régulièrement invoquée, ne saurait lui éviter la répression puisqu'il
est coupable d'un comportement qui le désigne sinon comme l'unique
auteur, du moins comme l'un des coauteurs ou complice du délit 4.
Parce qu'elle est une « infraction technique » solidaire du
régime d'imputation des infractions non intentionnelles, l'infraction
de travail dissimulé, et aussi sans doute les autres infractions de
travail illégal, sont justiciables des mêmes solutions quant au choix
désormais essentiel entre cumul et non-cumul des responsabilités,
lequel, va certainement conduire à terme à une réelle montée en
puissance de la responsabilité pénale des personnes morales et, à
l'inverse, à une relative régression de la responsabilité des décideurs.
Au fur et à mesure des arrêts, la Cour de cassation complète et précise
le régime juridique de la délégation de pouvoirs, dont on n'a cessé de
souligner l'importance tant en ce qui concerne la responsabilité pénale
qu'en ce qui concerne la gestion et l'organisation de l'entreprise. Par
une série de récentes décisions, elle a apporté des éclairages sur la
nature de la délégation ainsi que sur les responsabilités pénale et
civile du délégant et du délégataire.
L'arrêt du 14 mars 2006 5
constitue sans doute l'une des décisions les plus marquantes en la
matière. La cour d'appel avait jugé que le cogérant devait être tenu
pour pénalement responsable dès lors que la délégation de pouvoir qu'il
invoquait était celle accordée par l'ancien employeur et qu'il ne
faisait état d'aucune délégation de pouvoir consentie par le nouveau.
Les juges du fond avaient ainsi considéré que la délégation de pouvoir
prend fin en cas de changement d'employeur, à charge pour le nouvel
employeur, souhaitant conserver l'ancien délégataire de procéder à une
nouvelle investiture.
Mais la Haute Juridiction semble faire sienne
la thèse du pourvoi qui, après avoir rappelé que les contrats de
travail en cours au jour de la modification de la situation juridique
de l'employeur subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise en vertu de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du
travail, affirmait au contraire que « la clause d'un contrat de
travail instituant une délégation de pouvoirs en faveur du salarié
persiste après le changement d'employeur ».
La cassation est encourue car les juges du fond auraient dû « davantage s'expliquer sur les conditions et effets de la délégation de pouvoir invoquée
», ce qui laisse clairement entendre que pour les hauts magistrats la
seule circonstance que l'entreprise a été transférée ne saurait bloquer
le jeu de la délégation et interdire au dirigeant poursuivi d'invoquer
son rôle exonératoire, même s'il n'en a pas été l'initiateur.
Cependant, en se bornant à censurer pour insuffisance ou
contradiction de motifs, la Cour de cassation ne livre elle-même aucune
explication quant à l'alignement du régime de la délégation de pouvoirs
sur celui du contrat de travail, ce qui pourtant eût été d'autant plus
utile que la position de la cour d'appel n'était pas dénuée de tout
fondement.
En effet, au-delà de son intérêt en termes de responsabilité, la
délégation de pouvoir constitue une composante objective de
l'organisation de l'entreprise 6. La Haute Juridiction fait d'ailleurs parfois référence à « la structure de l'entreprise et aux conditions dans lesquelles celle-ci exerce son activité » 7.
Si on suit ce raisonnement, la délégation de pouvoir consentie par
l'employeur dans l'ancienne organisation devrait s'apprécier au regard
de la nouvelle organisation. A titre d'exemple, l'on peut se trouver en
présence de deux délégations de pouvoir ayant le même objet, consenties
à deux salariés différents, ou encore, le préposé délégataire de
l'ancienne organisation peut, dans la nouvelle organisation et compte
tenu d'éléments divers, se retrouver dépourvu des compétences, de
l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission.
Or, l'arrêt d'appel présentait l'intérêt d'attirer l'attention,
d'une part, sur le fait que le nouvel employeur doit s'assurer de
l'opportunité de maintenir ou non la délégation de pouvoir dans la
nouvelle organisation 8, d'autre part, sur l'utilité
d'indiquer dans la délégation de pouvoir le sort de celle-ci en cas de
changement dans la personne du délégant ou en cas de modification dans
la situation juridique de l'employeur.
Mais en dépit de ce laconisme, la solution finalement retenue a le
mérite de la clarté. Elle peut du reste trouver le soutien d'une
jurisprudence en matière de preuve de l'existence d'une délégation de
pouvoir puisque la Cour de cassation avait déjà énoncé sur ce point que
la délégation ne constitue pas une convention autonome mais une
modalité d'exécution du contrat de travail 9.
Cependant, pour l'interprète, d'autres questions surgissent, et
notamment celle de savoir s'il faut considérer que la délégation de
pouvoir fait partie de la matière contractuelle. De proche en proche,
le fait pour le chef d'entreprise de la société dominante d'un groupe
de déléguer ses prérogatives au préposé d'une filiale, ce que la
chambre criminelle admet par ailleurs, établirait-il l'existence d'un
contrat de travail entre celui-ci et l'entreprise dominante ?
La portée de l'arrêt du 14 mars 2006 va donc bien au-delà de ce qu'il suggère à première lecture 10.
Nul doute que les conséquences de la solution qui y est énoncée,
lesquelles n'ont pas toutes encore été mises en évidence, poseront
quelques difficultés compte tenu de la complexité des relations entre
le pouvoir de direction et le contrat de travail.
La délégation de pouvoir emportant transfert de responsabilité, la
responsabilité pénale pour un manquement relevant du domaine délégué
est alternative et non cumulative en ce sens que la même infraction ne
peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et le préposé
titulaire d'une délégation de pouvoir11, solution également rappelée par l'arrêt du 14 mars 2006.
Sur ce second point, la cour d'appel avait jugé que la
responsabilité du directeur d'exploitation était engagée, concurremment
à celle du cogérant, pour les contraventions aux temps de repos.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui souligne à juste titre que «
la responsabilité pénale des infractions poursuivies ne pouvait être
cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et un préposé en
raison des mêmes manquements ».
Pour comprendre cette solution, il convient de rappeler que la Cour
de cassation fait remonter la responsabilité pénale au chef
d'entreprise, ce qui va de soi lorsque certaines obligations légales
lui sont personnellement imposées, en considérant que la situation
délictueuse résulte de ce qu'il n'a pas correctement exercé son pouvoir
dont la nature lui permettait d'influencer le comportement de l'auteur
matériel 12.
Rappelons également que la délégation de pouvoir a pour effet,
sinon d'ériger le délégataire en chef d'entreprise dans le champ précis
de la délégation, à tout le moins d'établir une équivalence entre le
premier et le second 13 dès lors que le substitut est
pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à sa
mission, élément de détermination de l'individu pénalement responsable 14.
Il s'ensuit que la responsabilité pénale ne peut être
cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et le préposé
délégataire, assimilé au premier, pour un même manquement. Le terme de
« responsabilité substituée » 15 a le mérite de rendre compte du mécanisme et permet de comprendre la solution retenue par la Cour de cassation.
Il convient néanmoins de se garder de considérer que le chef d'entreprise délégant est totalement à l'abri de toute poursuite.
En effet, en droit pénal général, chacune des personnes ayant
commis les actes répréhensibles peut en principe voir sa responsabilité
engagée, la Cour de cassation ayant d'ailleurs jugé que la
responsabilité des dirigeants de la personne morale ne fait pas
obstacle à ce que soit aussi retenue la responsabilité de ceux qui ont,
avec ces dirigeants, accompli les actes matériels constitutifs de
l'infraction 16. Il n'est donc pas à exclure que la
responsabilité Etudes et doctrine RJS 2/08 du chef d'entreprise
délégant soit recherchée sur le terrain de la complicité ou de la
coaction, mais ce ne sera pas pour violation de l'obligation transférée.
Bien qu'il ait délégué ses prérogatives, le chef d'entreprise demeure
responsable des obligations qui lui sont spécialement imposées en tant
qu'elles ressortissent de sa compétence exclusive 17.
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 mai 2007 18
illustre fort bien l'hypothèse dans laquelle une délégation de
pouvoirs, même régulièrement donnée à un collaborateur du chef
d'entreprise, ne met pas ce dernier à l'abri de toute condamnation
pénale pour les infractions commises dans l'un de ses établissements et
qui semblent a priori se rattacher au domaine délégué.
L'infraction
concernée par l'arrêt n'est autre que le délit d'entrave aux
institutions représentatives des salariés lorsque la règle violée
concerne les attributions d'une instance représentative du type comité
(d'entreprise, d'établissement, central, de groupe ou encore CHSCT) qui
nécessite information et/ou consultation préalable des élus par
l'employeur. L'élision du jeu exonératoire de la délégation résulte
alors de la formule suivante : «Même s'il confie à un représentant
le soin de présider le comité (central) d'entreprise, le chef
d'entreprise engage sa responsabilité à l'égard de cet organisme
s'agissant des mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction,
sans pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de pouvoirs.»
La solution est constante depuis un arrêt du 15 mars 1994 19.
Elle
s'explique fondamentalement par le partage du rôle d'interlocuteur de
la représentation du personnel entre le chef d'entreprise et les
membres de sa hiérarchie, certaines obligations légales devant demeurer
en toute hypothèse à la charge du premier parce qu'étant indissociables
du pouvoir qu'il détient 20.
Mais ce que la formule
jurisprudentielle plus haut citée sinon révèle du moins clarifie, c'est
la clef de répartition permettant de dire si le fait illicite
constitutif de l'entrave par défaut d'information ou de consultation du
comité ne doit, en toute hypothèse, être reproché qu'au chef
d'entreprise ou s'il peut éventuellement être reproché à un substitut.
En l'espèce, en effet sont condamnés pénalement à la fois, mais pour
des faits distincts, le président du directoire de la société employeur
et le directeur adjoint des affaires sociales, le second dans le cadre
de la délégation donnée par le premier pour présider le comité
d'entreprise. Apparaît ainsi un partage entre les infractions d'entrave
qui se rapportent aux aspects purement procéduraux du fonctionnement de
l'institution représentative, tels que l'établissement de l'ordre du
jour des réunions et la transmission, dans les délais impartis, de
l'ensemble des documents utiles à l'information et à la consultation,
infractions imputables au délégataire habilité à présider, et de
l'autre, les infractions qui restent rattachables au pouvoir de
direction du délégant telles que l'établissement de bilans sociaux
incomplets ou la fourniture insuffisante aux élus de moyens matériels
de travail et plus généralement, ce qui se rattache à la compétence
consultative du comité 21.
Susceptibles d'être
cumulées, les responsabilités des personnes physiques en matière
d'entrave sont donc également tributaires de la nature de l'obligation
violée et du niveau de pouvoir auquel celle-ci se rattache a priori,
qu'il y ait eu ou non délégation.
L'on sait que le salarié condamné pénalement n'engage sa responsabilité
civile à l'égard des tiers que s'il a excédé les limites de la mission
qui lui a été impartie par l'employeur 22.
On imagine aisément la difficulté de déterminer au cas par cas si le
salarié a agi ou non dans les limites de ses fonctions et ce, d'autant
que le manquement reproché à un préposé au titre de la délégation de
pouvoir entretient généralement un lien très étroit avec ses
attributions.
Il ressort d'un arrêt du 28 mars 2006 23
que le délégataire avait été reconnu coupable d'homicide et blessures
involontaires ainsi que d'infraction à la réglementation sur la
sécurité des travailleurs en omettant de s'assurer que les travaux
menés étaient accomplis conformément aux règles de sécurité prévues par
décret et que ce manquement a contribué à créer la situation ayant
permis la réalisation du dommage, les juges ayant ajouté que compte
tenu de la nature des travaux dont il ne pouvait ignorer les risques,
le délégataire avait violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi
ou le règlement. Mais, de façon plus originale, ce délégataire avait
également été condamné à réparer le préjudice qui en était résulté pour
les proches de la victime au sens de l'article L 451-1 du Code de la
sécurité sociale.
Dans son pourvoi, l'intéressé contestait cette condamnation en
soutenant que sa responsabilité civile ne pouvait être retenue dès lors
qu'il avait agi dans l'exercice normal de ses fonctions même si
l'exécution de celles-ci était défectueuse. Cette argumentation
s'inscrivait donc dans la droite ligne de l'arrêt Costedoat, tout en
tenant compte de l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001 24 par
lequel l'Assemblée plénière a jugé que la responsabilité civile du
préposé à l'égard des tiers est engagée lorsque celui-ci a commis une
infraction intentionnelle. Il était en effet soutenu par le pourvoi que
« poursuivi en qualité de préposé de la société () du chef
d'infractions non intentionnelles, le prévenu ne pouvait être déclaré à
titre personnel civilement responsable des conséquences dommageables de
celles-ci qu'à la condition qu'il n'eût pas trouvé les moyens de
commettre l'infraction dans ceux mis à sa disposition pour assurer son
emploi ou qu'il eût agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses
attributions, hors des fonctions auxquelles il était employé ».
Pour dire que ces griefs n'étaient pas de nature à donner lieu à cassation, la chambre criminelle pose en règle que « le
préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute
qualifiée au sens de l'article 121-3 du Code pénal, engage sa
responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction,
celle-ci fût elle commise dans l'exercice de ses fonctions ». La
solution ainsi dégagée ne semble pas de nature à prêter le flanc à la
critique sur le plan juridique au regard des constatations relevées par
la cour d'appel. En effet, usant de son pouvoir d'appréciation
souveraine, celle-ci avait retenu que le délégataire avait, de manière
délibérée, violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement. Il s'agit là d'une faute qualifiée,
exigée dans le cadre de la causalité indirecte à laquelle est rattachée
la responsabilité pénale du chef d'entreprise ou de ses substituts et
qui caractérise une omission dont le délégataire devait avoir
conscience, ou qu'il ne pouvait ignorer, pour reprendre les termes de
l'arrêt d'appel 25.
On est ainsi conduit à considérer
que l'autorité et l'autonomie inhérentes à la délégation de pouvoir
ainsi que le caractère délibéré de la faute qualifiée établissent que
le préposé délégataire a couru le risque de voir se réaliser les
conséquences de son manquement, lequel est ainsi détaché de ses
attributions de délégataire de telle sorte que sa responsabilité civile
doit être engagée. Finalement, l'arrêt ne s'écarte pas réellement de la
jurisprudence de la Haute Juridiction et s'inscrit même dans les
interstices des solutions dégagées par les arrêts Costedoat et Cousin.
On ne peut qu'espérer que les tribunaux s'en tiendront à cette
lecture de l'arrêt car l'extension de la solution ainsi dégagée aux
infractions techniques risquerait fort de freiner la mise en place
concrète de la délégation de pouvoir. En effet, l'on voit mal quel
serait alors l'intérêt pour le salarié d'accepter une délégation de
pouvoir ayant de telles conséquences sur le plan de la responsabilité
civile en plus de celles qu'il assume du point de vue pénal.
Or, on
ne dira jamais assez que la pérennité du mécanisme de la délégation se
justifie d'abord par la vertu préventive de la responsabilité pénale.
On reviendra sur l'arrêt du 20 mars 2007, déjà commenté en première
partie dans lequel à côté de l'infraction de travail dissimulé
reprochée au dirigeant unique des trois sociétés, les délits de prêt
illicite de main-d'oeuvre et de marchandage avaient été retenus à
l'encontre de l'une des personnes morales en situation d'utilisatrice
de salariés formellement rattachés à une autre.
Or, les juges du fond ont été censurés sur ces deux chefs de
condamnation car, aux yeux de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, ils n'ont pas suffisamment caractérisé le but lucratif de
l'opération ayant consisté pour le gérant commun à avoir transféré sans
justification économique dans l'une ou l'autre des trois sociétés,
leurs salariés respectifs.
La Cour de cassation rappelle à cette occasion que le but lucratif
peut consister du côté de l'utilisateur ou du prêteur de main d'oeuvre
en « un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire ».
En l'espèce, les prêts de main-d'oeuvre étaient incontestables, les
salariés concernés n'avaient pas été mis à disposition par un vrai
contrat d'entreprise ou de sous-traitance. Peu explicitée, la raison de
cette mise à disposition était vraisemblablement d'ordre social, les
salariés étant affectés à l'une ou à l'autre société uniquement pour
apaiser leurs revendications (sans doute la crainte du chômage
technique) et comme l'avait dit la cour d'appel : « sans justification économique ».
En outre, il était clair que ces salariés exerçaient leur activité
sous l'autorité et avec les camions d'une société autre que celle qui
les rémunérait. Mais sur le nécessaire constat du but lucratif de
l'opération, la cour d'appel aurait dû aller moins vite en besogne et
ne pas se contenter d'énoncer de façon lapidaire que : « Le recours
systématique au prêt de main-d'oeuvre présente un caractère lucratif
puisqu'il permet de procéder à une refacturation non conforme à la
situation réelle. »
Une première méthode exempte de critiques eû t consisté, sans
doute, à rechercher si les salariés en cause étaient « loués » plus
cher qu'ils n'étaient rémunérés. Mais en l'occurrence, compte tenu des
liens entre les sociétés, un tel constat pouvait difficilement être
fait, le prêteur n'étant pas motivé par le lucre. Cependant, aux termes
d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation 26,
le but lucratif caractéristique du délit est également présent lorsque
c'est l'entreprise emprunteuse qui cherche à réaliser des économies en
ne payant pas les charges sociales correspondantes 27, ce
qui suggère une méthode complémentaire susceptible de s'appliquer en
l'espèce, car si comme les juges du fond l'ont affirmé, il y avait
refacturation non conforme à la situation réelle, n'était-ce pas pour
permettre à la société utilisatrice de réaliser de telles économies ?
Pourtant, la Cour de cassation ne voit pas le but lucratif dans
l'opération. S'agirait-il d'un revirement sur ce qu'il faut entendre
par but lucratif au sens des textes concernés ? Ceci n'est guère
probable, d'autant encore une fois que la Haute Juridiction prend soin
de préciser dans son arrêt que le but lucratif peut consister notamment
en un « gain pécuniaire », expression très large susceptible
d'englober l'économie de charges sociales résultant mécaniquement pour
l'utilisateur de la fourniture d'un personnel ne lui appartenant pas.
Loin de l'espoir chimérique de voir évoluer une jurisprudence parfois vivement critiquée 28,
la bonne piste interprétative paraît se situer dans la prise en compte
d'une situation particulière, mais néanmoins non exceptionnelle, formée
par un groupe de sociétés fortement intégré, au destin unique. Ceci
serait de nature à rendre plus exigeant le constat du but lucratif
lequel supposerait un véritable profit réalisé grâce à la main-d'oeuvre
prêtée par l'une au moins des personnes morales concernées.
La Haute Juridiction livre un indice en ce sens lorsqu'elle évoque les « intérêts communs aux trois sociétés »
qui forment en fait une seule entité économique. Le parallèle est
tentant avec la jurisprudence sur l'abus de biens sociaux qui, depuis
l'arrêt Rosenblum, réserve un sort particulier aux dirigeants des
groupes de sociétés en voyant dans les intérêts communs du groupe un
fait justificatif propre à cette infraction si diverses conditions
spécifiques sont réunies 29. Allant plus loin, on se
demandera si les sociétés concernées ne formaient pas en fait une seule
et même entité assimilable à une entreprise, à l'instar de l'unité
économique et sociale consacrée par la jurisprudence sociale en matière
d'institutions représentatives du personnel.
Aussi bien,
l'appartenance à un même groupe de sociétés fortement intégré pourrait
s'avérer être à la fois le meilleur et le pire dans des poursuites
fondées sur de telles infractions. Le meilleur dès lors que la
solidarité économique explique et justifie le va et vient de personnels
entre sociétés et une facturation croisée.
Le pire, dès lors que, comme le montrent d'autres affaires, le lien
sociétaire est utilisé pour mettre en place une fourniture
conventionnelle de la main-d'oeuvre qui dissocie artificiellement les
rôles d'employeur et d'utilisateur 30.
L'infraction de l'article 226-15 du Code pénal 31 mérite
également d'être envisagée dans ses éventuelles applications à
l'entreprise, que la victime de la violation du secret soit le salarié
ou l'employeur, car au-delà des courriers classiques, c'est la
correspondance électronique qui est concernée dès lors qu'elle revêt un
caractère personnel 32.
Les virtualités d'un tel rattachement à la matière pénale ont cessé
d'être théoriques à partir de l'arrêt Nikon rendu par la chambre
sociale de la Cour de cassation le 2 octobre 2001, duquel il résulte
que l'activité professionnelle n'est pas exclusive de toute vie privée
et que celle-ci englobe les fichiers titrés comme personnels, lesquels
ne sont pas séparables des courriels envoyés ou reçus par les salariés
avec la même précision 33.
Mais ces répercussions de
l'évolution des supports des courriers sur le jeu de la règle pénale,
évidentes lorsqu'il s'agit des courriers personnels des salariés,
pourraient également sans doute être observées à propos des courriels
d'entreprise protégés eux aussi, a priori, par le secret des
correspondances dès lors qu'ils revêtent les caractéristiques
objectives d'une correspondance privée 34.
La
contre-épreuve résulte des tentatives faites, de lege ferenda, pour
tracer une frontière entre le courriel professionnel et le courriel
personnel afin d'exclure ensuite le premier du champ de la protection
du secret sur la seule base de critères formels 35. Sauf à
ce que le législateur se rallie à une telle solution, les courriels
d'entreprise ont donc eux aussi vocation à être protégés, y compris par
la loi pénale, contre toute intrusion venant non seulement de tiers
mais aussi de membres de l'entreprise dès lors que ces derniers n'ont
pas été habilités à en prendre connaissance.
Mais quels sont exactement les contours de l'infraction ? Si
l'alinéa 1er de l'article 226-15 du Code pénal énonce la règle la plus
générale 36, c'est l'alinéa 2 qui concerne plus directement la protection des messages électroniques en ce qu'il sanctionne : « Le
fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser
ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la
voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils
conçus pour réaliser de telles interceptions.» L'avenir dira si
l'élément matériel de l'infraction doit être appréhendé uniquement à
partir de ce deuxième alinéa lorsqu'il s'agit de courriers
électroniques ou cumulativement, à partir du premier et du second, ce
qui pourrait déboucher sur des solutions sensiblement différentes en
jurisprudence dans la mesure où une partie seulement des comportements
illicites est commune aux deux alinéas 37.
A tout le moins une chose est sûre, l'infraction requiert dans tous les cas une intention comme l'attestent les expressions : « faits commis de mauvaise foi
» ou « prendre frauduleusement connaissance » du contenu du courrier.
Cet élément moral impose donc la démonstration que le prévenu avait
réellement conscience de ce que la correspondance ne lui était pas
destinée et qu'il l'a néanmoins ouverte ou qu'il l'a volontairement
conservée pour empêcher ou retarder sa transmission au destinataire 38.
Or cette preuve nécessaire de l'intention malveillante pose la question
de la correspondance électronique interceptée ou divulguée par mégarde,
laquelle ne devrait normalement pas conduire à l'affirmation d'une
responsabilité pénale, même s'il est indiscutable qu'il s'agit de
messages personnels relevant de l'intimité de la vie privée.
L'hypothèse est parfaitement illustrée par l'affaire tranchée en
chambre mixte le 18 mai 2007, par la Cour de cassation, dans laquelle
un chauffeur de direction s'était fait adresser sur son lieu de travail
une revue pornographique à laquelle il était abonné. Arrivé sous
enveloppe commerciale avec pour seules habituelle et connue du salarié.
Mais l'employeur, ayant appris la chose, sanctionnera l'intéressé,
lequel répliquera aux prud'hommes en invoquant la violation de
l'intimité de la vie privée et du secret des correspondances 39.
En raison des implications multiples de la solution, l'examen du
pourvoi a été confié à une chambre mixte largement composée, laquelle
après avoir constaté que le courrier en question avait pu être
considéré par erreur comme n'ayant pas une nature personnelle à défaut
de mentions explicites en ce sens, a décidé que son ouverture par
l'employeur était licite et que ce dernier n'avait nullement violé le
secret des correspondances.
Même si la Cour de cassation censure par ailleurs l'arrêt attaqué pour une mauvaise application du droit disciplinaire 40,
elle se situe, pour ce qui nous concerne, dans la continuité de la
jurisprudence de la chambre criminelle, laquelle, par une décision du
16 janvier 1992 41, avait déjà jugé que l'absence
d'indication du caractère privé sur les enveloppes contenant la
correspondance litigieuse faisait obstacle à l'établissement de
mentions son nom, sa fonction et l'adresse de l'entreprise, le pli a
été ouvert par le service courrier, conformément à une pratique
l'intention frauduleuse de celui qui les avaient ouvertes et que ces
lettres avaient à juste titre été considérées comme professionnelles et
non personnelles 42.
On ne voit pas au nom de quoi un tel raisonnement appliqué aux courriers « papier », ne serait pas transposable aux courriels.
Bien au contraire, comme le souligne l'avocat général dans son avis
sous l'arrêt de la chambre mixte précité, il résulte de la
jurisprudence sociale que, si le courrier, virtuel ou non, n'est pas
identifié comme étant personnel, il peut être présumé avoir un
caractère professionnel et l'employeur peut y avoir accès hors la
présence du salarié.
Si cette conclusion se rapporte d'abord à la jurisprudence de la
chambre sociale qui est à l'origine d'une telle présomption, la source
de l'arrêt rendu le 18 mai 2007 autorise à y voir une règle de portée
plus générale dont l'application devrait conditionner à l'avenir le
débat sur l'infraction pénale elle-même. En d'autres termes, l'absence
de mention du caractère personnel sur un courrier quel qu'il soit,
devrait faire obstacle à la mise en cause pénale de ceux, personnes
physiques ou morales, qui ont pris l'initiative de l'ouvrir en
l'absence du salarié, voire même après un refus de coopérer de la part
de celui-ci 43.
A défaut de telles circonstances caractéristiques de la bonne foi,
la voie reste cependant étroite pour qui veut se défendre en attaquant,
comme l'illustre un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 24
novembre 2005 dans une affaire où un employeur avait licencié l'un de
ses salariés pour faute grave après avoir intercepté divers e-mails
dans la messagerie électronique de celui-ci, démontrant la réalité
d'actes de concurrence déloyale de sa part.
Bien que victime d'un
comportement illicite, cet employeur a néanmoins été condamné pour
atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication, le
détournement pénalement sanctionné ayant consisté à effectuer diverses
manoeuvres dont la réinitialisation du mot de passe et l'impression des
pages choisies, ce qui, aux yeux des juges, démontrait que le prévenu
avait conscience de s'approprier les documents qu'il savait appartenir
à la partie civile, à son insu et contre son gré 44.
Dans ces conditions, et à moins que la Cour de cassation prenne un
parti différent, il paraît plus sage pour l'employeur de s'adresser au
juge de l'urgence et de solliciter une expertise in futurum sur le
fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'accéder à
la messagerie personnelle d'un salarié à l'égard duquel il nourrirait
des soupçons de déloyauté 45.
Codifié dans un chapitre sur les atteintes à la dignité de la personne,
l'article 225-1 du Code pénal définit la discrimination comme « toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse,
de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé,
de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée ».
A la lecture de cette disposition principale 46, on comprend
que l'ordre juridique n'admet pas que l'on puisse séparer des
individus, établir entre eux une différence péjorative à partir de
certaines considérations dont on a jugé qu'elles portent atteinte à la
dignité de la personne humaine. Celle-ci étant commune à tous les
hommes, certains ne sauraient être écartés d'un bien ou d'un service,
être traités moins bien - et donc plus généralement être privés de
s'accomplir - pour certains motifs, lesquels sont désormais énumérés de
façon très complète à l'article 225-1 du Code pénal. L'infraction de
discrimination suppose donc que l'on établisse, d'une part, qu'un
critère prohibé a été retenu pour prendre une décision ou exprimer un
refus et, d'autre part, que ce critère a été à l'origine de la
différence de traitement dans l'une des situations visées à l'article
225-2 de ce même Code.
Si certains arrêts ne font pas clairement mention de l'élément
matériel de l'infraction, d'autres, au contraire, soulignent,
conformément au texte d'incrimination, qu'un motif interdit a été pris
en compte et qu'il a joué un rôle causal par rapport à la décision
contestable. A titre d'exemple, bien que son arrêt en date du 5 juin
2005 ait été cassé en ce qu'il a débouté la partie civile de ses
demandes, la cour d'appel de Montpellier a pris soin d'indiquer, pour
confirmer la relaxe des prévenus, que « rien n'établit que le refus opposé est basé sur un critère racial propre aux intéressés » 47.
A l'inverse, pour entrer en voie de condamnation du chef de
discrimination, la cour d'appel de Rennes a relevé, dans un arrêt en
date du 4 juillet 1996 48, que le prévenu avait « subordonné la prise de possession et la remise des clefs à des conditions n'ayant d'autre raison que l'état de santé
» de la victime. En outre, il convient de rappeler que la
discrimination est une infraction intentionnelle pour laquelle doit
être caractérisé un dol spécial consistant dans la volonté
discriminatoire 49. On peut regretter que celle-ci ne soit
pas suffisamment mise en évidence dans les décisions, même si le juge
pénal peut, au titre de l'intime conviction, la déduire des faits
matériels qui lui sont soumis, ce qui sera facilité lorsque ceux-ci
seront reconnus 50.
La rigueur exigée quant aux éléments constitutifs du délit de
discrimination et à sa preuve ne vise nullement à satisfaire un caprice
de juriste mais bien à renforcer la lutte contre ces comportements
considérés comme socialement destructeurs en condamnant seulement
lorsque les faits révèlent que l'infraction est constituée dans tous
ses éléments. A défaut, le rôle dissuasif de la répression ne serait
pas atteint. Ceci éclaire au passage tout l'enjeu qui s'attache au bon
accomplissement de la mission confiée à la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l'Egalité (Halde) ainsi qu'à ses
médiateurs. Cette mission ne sera menée à bien que si les réclamations
sont, de la recherche d'une éventuelle discrimination à la sanction,
traitées avec toute la rigueur exigée. L'enjeu est d'autant plus
important que les plaignants ont semble-t-il délaissé la plainte au
parquet pour s'orienter de plus en plus vers les procédures mises en
oeuvre par la Haute Autorité et pouvant aller désormais jusqu'à la
transaction pénale avec citation directe en cas d'échec.
Si la répression de la discrimination concourt à garantir la
dignité, qui est un attribut essentiel de la personne humaine, l'on n'a
pas manqué de constater que, dans certaines situations, il est
particulièrement difficile d'apporter la preuve des faits
discriminatoires.
Cependant, le régime probatoire prévu par le Code du travail 51
n'a pas vocation à s'appliquer dans le procès pénal comme l'a récemment
rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 avril 2007 52.
Le rapport sur le projet de loi pour l'égalité des chances énonçait d'ailleurs qu'« il
convient () d'observer que le présent article [225-3-1 du Code pénal]
concerne exclusivement le champ pénal. Dans les contentieux civils
relatifs notamment aux questions d'emploi et traités par le juge
prud'homal ou le juge administratif, la preuve de la discrimination est
en effet déjà régie par des dispositions spécifiques ».
Pour autant, si en matière pénale, la preuve de la discrimination
ne fait l'objet d'aucune disposition particulière et reste soumise aux
règles du droit commun, l'article 45 de la loi précitée a inséré dans
le Code pénal une nouvelle disposition qui, au moins pour certaines
discriminations, ménage le droit commun. En effet, aux termes de
l'article 225-3-1, « les délits prévus par la présente section sont
constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs
personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats
mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du
comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement
est établie ».
Défini comme « l'opération qui vise à déceler des comportements
discriminatoires en effectuant successivement des démarches analogues
au nom de personnes différentes par l'origine ou l'appartenance » 53, le « testage
» avait déjà été admis comme moyen de preuve licite par la Haute
Juridiction de l'ordre judiciaire qui, au visa de l'article 427 du Code
de procédure pénale, avait jugé qu'« aucune disposition légale ne
permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par
les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenu de façon illicite
ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement, en application du texte
susvisé, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la
discussion contradictoire » 54.
Autrement dit, quand bien même il constituerait un moyen de preuve
déloyal, il ne peut être écarté et le juge pénal doit en apprécier la
valeur probante.
Par le biais de la candidature fictive, mise en
place pour la circonstance, le testage permettrait d'établir que la
candidature réelle, sur laquelle repose l'élément matériel de
l'infraction, a été écartée pour des motifs prohibés. Selon le rapport
sur le projet de loi « il s'agit bien de spécifier que le délit de discrimination est constitué même si les "victimes" n'ont demandé ce bien, service ou emploi que pour établir qu'il leur est refusé pour un motif prohibé
». L'employeur pourrait alors faire valoir, notamment par comparaison
avec les candidatures auxquelles une suite a été donnée dans le cadre
de la même procédure de recrutement, que des informations relatives aux
motifs prévus par l'article 225-1 ne sont pas entrées en ligne de
compte pour retenir ou écarter une candidature et qu'il a été donné
suite à des candidatures présentant des traits similaires à ceux du
plaignant.
Il apparaît néanmoins difficile de contester l'élément matériel de
l'infraction dès lors que le testage établit que, sur les deux
candidatures au contenu identique, a été retenue celle comportant des
données dont le plaignant affirme qu'elles constituent des motifs
discriminatoires.
La Direction des affaires criminelles du ministère de la justice en déduit pour sa part que « si
une personne véritable, donnant des renseignements exacts sur son
identité et sa qualité, par exemple à l'occasion d'une demande
d'embauche ou de location, se voit opposer un refus, alors que, pour
démontrer le caractère discriminatoire de ce refus, il avait été
adressé dans le même temps une demande similaire - sauf sur l'identité
et l'origine de la personne - et qu'à la suite de cette demande un
entretien d'embauche a été proposé ou la location a été acceptée,
l'infraction sera caractérisée, en dépit du caractère fictif de la
seconde demande » 55.
La politique du ministère public en matière de traitement et de
poursuites de la discrimination devrait, de façon réflexe, conduire les
entreprises à définir des procédures permettant d'établir que des
motifs prohibés ne sont pas pris en compte dans le traitement des
candidatures.
Comme le sous-tend la circulaire, il revient à la victime de mener
le testage, éventuellement constaté par un huissier ou les services de
police, ce dont on peut déduire que seule la personne s'estimant
victime de discrimination est fondée à se livrer au testage.
Cette solution se justifie par deux raisons au moins. La première
tient au fait que si les officiers et agents de police judiciaire ont
compétence générale pour constater toutes infractions, ils ne sauraient
valablement se livrer d'eux-mêmes au test de discrimination, qui
constituerait alors une « provocation policière » en tant que
machination incitant un individu à commettre une infraction pour
ensuite rapporter la preuve de ses agissements délictueux, ce
stratagème viciant la recherche et l'établissement de la vérité 56.
La deuxième raison tient à la nature même du délit qui n'est pas
formel et suppose l'existence d'un préjudice, partie intégrante de
l'infraction. Le testage ne peut donc être décroché d'une situation
péjorative réelle et suppose à ce titre que la personne qui entend s'en
prévaloir ait subi un préjudice du fait de la discrimination. Ainsi, le
mode de preuve qu'est le test de discrimination entretient des liens
étroits avec les éléments de l'infraction et la valeur protégée.
L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 février 2007 57
concerne d'abord le délit d'entrave. Mais à ce premier titre il
n'apporte guère d'éclairage nouveau sur la manière dont cette
infraction est constituée. On serait tenté de qualifier les faits
poursuivis « d'entrave du premier type » tant les manquements sanctionnés participent d'une méconnaissance élémentaire des règles du Code du travail 58.
La décision est plus intéressante pour ce qui est des infractions
de discrimination syndicale et de harcèlement moral commises par le
même employeur au préjudice d'un délégué du personnel issu du premier
tour des élections et qui, après avoir fait l'objet d'une procédure de
demande d'autorisation de licenciement refusée par l'inspection du
travail, s'est vu affecté à des tâches ne correspondant pas à sa
qualification, a subi des retenues sur salaire injustifiées et a été
privé notamment des facilités de transport consenties gracieusement par
l'entreprise pour effectuer des déplacements professionnels
contrairement aux autres membres de la société occupant des fonctions
de nature identique aux siennes.
Il en est résulté une
dégradation des conditions de travail de l'intéressé altérant sa santé
physique et mentale, qui a conduit à fonder les poursuites pénales sur
l'incrimination de harcèlement moral de l'article 222-33-2 du Code
pénal, en parallèle de celle de discrimination syndicale prévue par les
articles L 412-2 et L 481-3 du Code du travail.
On ne reviendra pas sur la manière dont les éléments constitutifs
de chacun des deux délits ont été caractérisés et en particulier sur
les questions probatoires (voir supra) évoquant plutô t les
conséquences du choix par la partie poursuivante de deux qualifications
pénales applicables à une même situation de fait.
Les juges du fond avaient considéré que, bien que procédant des
mêmes agissements du prévenu, les infractions d'entrave au droit
syndical (lire « discrimination ») et de harcèlement moral
devaient toutes deux être retenues dès lors que ces infractions
sanctionnent la violation d'intérêts distincts. Ce faisant, ils avaient
écarté la thèse du cumul idéal qui conduit à ne retenir que la
qualification pénale la plus haute, pour constater un cumul réel
d'infractions, ce en quoi ils sont approuvés par la Cour de cassation.
En dépit de ses fortes évolutions, la lettre du Code pénal ne dit rien de cette hypothèse de cumul 59, qui constitue néanmoins une solution constante en jurisprudence, permettant de déroger à la règle « non bis in idem
». On en constate la présence en droit pénal du travail, par exemple en
matière d'hygiène et de sécurité, où il est jugé que les infractions
prévues par le Code du travail peuvent se cumuler avec les délits
homicide ou de blessures involontaires en cas d'accident car « elles
tendent à la protection d'intérêts collectifs ou individuels distincts
et peuvent dès lors être poursuivies simultanément ou successivement » 60.
Mais c'est sans doute en matière de délits d'entrave que la mise à
l'écart du cumul idéal dévoile le plus clairement l'orientation
répressive d'une telle solution qui consiste de la part de la chambre
criminelle à affirmer que pour être identiques, ces infractions n'en
sont pas moins distinctes les unes des autres aussi bien dans leur
élément matériel que dans leur élément légal, ce qui a pour conséquence
d'autoriser des poursuites différentes contre les mêmes personnes à
raison des mêmes faits 61. Dans la présente espèce
cependant, on peut se demander si le critère de la violation d'intérêts
distincts résultant d'agissements uniques est vraiment opératoire 62.
Certes, la discrimination syndicale, qu'elle soit envisagée par le Code
pénal (art. 225-1) ou par le Code du travail (art. L 412-2) paraît ne
réagir que contre des atteintes à l'exercice normal de la liberté
syndicale, alors que l'incrimination de harcèlement moral « protège
la personne humaine qui ne doit pas subir des agressions morales
répétées susceptibles d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir
professionnel » 63.
A partir de là, comment ne pas en conclure que les éléments
constitutifs de ces infractions sont différents et protègent des
intérêts distincts même s'il paraît excessif d'affirmer, comme l'ont
fait les juges du fond, que la prévention de harcèlement moral protège
le salarié ordinaire alors que celle de discrimination vise, au cas
particulier, l'employé pourvu d'un mandat représentatif ?
Raisonner
ainsi c'est toutefois sous-entendre que les valeurs protégées par
l'infraction de discrimination correspondent aux critères
discriminatoires eux-mêmes. Or, il n'en est rien car la lecture du Code
pénal enseigne que la valeur protégée est celle prévue par le chapitre
V du titre II du livre second dudit Code, à savoir la dignité de la
personne. Quant au harcèlement moral, s'il est rattaché aux « atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne »,
il défend explicitement la même valeur puisque l'article 222-33-2 fait
de l'atteinte à la dignité de la personne l'objet ou l'effet des actes
de harcèlement tombant sous le coup de la loi pénale 64.
Il y a donc dans cette configuration d'infractions une très grande
proximité pour ne pas dire une confusion des intérêts protégés rendant
peu opératoire le critère jurisprudentiel précité et incitant plutôt à
faire un choix entre l'une ou l'autre qualification, ce qui, eu égard
aux circonstances propres à l'espèce jugée le 6 février 2007, aurait dû
conduire à privilégier la qualification de discrimination. L'option
semble d'importance compte tenu du « couplage » fréquent entre les reproches de discrimination et de harcèlement, dont du reste se fait écho le dernier rapport de la Halde 65.
_______________________________________
1 Cass. crim. 20 mars 2007 no 05-85.253 : RJS 7/07 no 898.
2 Voir les références citées in Droit pénal du travail, E. Fortis et A. Coeuret : Litec éd. 2004 nos 753 et s.
3 Pour une approche plus complète des problèmes posés par la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, voir notre étude dans la RJS 11/06 chron. p. 843.
4 Voir en ce sens l'analyse lumineuse de J.-H. Robert : Dr. pén. Juin 2007 comm. no 88.
5 Cass. crim. 14 mars 2006 no 05-85.889 : RJS 7/06 no 911.
6 L'influence du droit pénal sur l'organisation de la sécurité dans l'entreprise, D. Mayer : D. 1998 p. 20 ; La délégation de pouvoirs, Recueil par le droit d'un mode d'organisation de l'entreprise, A. Coeuret : Revue Personnel ANDCP juin 2005 p. 44.
7 A titre d'exemple voir Cass. crim. 1er octobre 1991 no 90-85.024.
8 La Cour de cassation s'était déjà prononcée en ce sens : Cass. crim.25 juin 1991 : RJS 10/91 no 1099.
9 Cass. crim. 21 décembre 1982, inédit.
10 Précisons que l'arrêt énonce un principe sur le seul point de savoir si la délégation de pouvoir expressément prévue par le contrat de travail se poursuit également auprès du nouvel employeur, sans pour autant se prononcer sur la validité de la délégation en cause. Il convient donc de se garder de considérer qu'une clause contractuelle suffit à la validité de la délégation de pouvoir. Bien au contraire, le seul fait d'indiquer dans un contrat de travail que le salarié reçoit délégation de pouvoir est insuffisant à sa validité puisqu'il est de jurisprudence constante que la délégation de pouvoir doit être précise, claire et avoir un objet limité. C'est sans doute ce qu'entendait mettre en exergue la cour d'appel en retenant que la délégation de pouvoir ne peut être prise en compte dès lors qu'il en est seulement fait état dans le contrat de travail. Il lui revenait néanmoins, comme l'a déclaré la chambre criminelle, de s'expliquer davantage sur les conditions et effets de la délégation de pouvoir en cause.
11 Cass. crim. 23 janvier 1975 : Bull. crim. no 30 ; Cass. crim. 10 février 1976 : Bull. crim. no 25.
12 C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la chambre criminelle dans l'arrêt du 28 mars 2006 ci-dessous évoqué. Voir également « La nouvelle donne en matière de responsabilité », A. Coeuret : Dr. soc. no 7/8 1994 p. 628.
13 La délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité du travail : réflexions sur la condition d'autorité, A. Coeuret et R. Zannou : Revue Personnel ANDCP juin 2006, p. 12.
14 De son côté, la chambre sociale de la Cour de cassation en conclut logiquement que le salarié titulaire d'une délégation de pouvoir, plus précisément d'une « délégation écrite particulière d'autorité », exerce des prérogatives l'assimilant au chef d'entreprise (Cass. soc. 4 juin 2003 no 02-60.353 : RJS 11/03 no 1286 ; Cass. soc. 1er février 2006 no 05-60.163 : RJS4/06 no 469 ; Cass. soc. 12 juillet 2006 no 05 60.300 : RJS 11/06 no 1200). Précisons que la condition d'autorité ainsi entendue renvoie directement au pouvoir, c'est-à-dire à la capacité d'obtenir de l'autre une conduite déterminée et constitue un indice privilégié d'identification de la personne pénalement responsable.
15 Droit Pénal du travail, A. Coeuret et E. Fortis, éd. 2004 p. 157.
16 Cass. crim. 18 mai 1994 no 93-81.883 : RJDA 5/95 no 658.
17 Cass. crim. 15 mars 1994 no 93-82.109 : RJS 6/94 no 708.
18 RJS 8-9/07 no 969.
19 RJS 5/94 no 708, Bull. crim. no 100, s'agissant du défaut de consultation d'un CHSCT. Dans le même sens pour le comité d'entreprise, Cass. crim. 3 mars 1998 : RJS 6/98 no 749, Bull. crim. no 81. Voir également Cass. crim. 14 octobre 2003 : RJS 1/04 no 64.
20 Ce qui ne veut pas dire que même lorsque le chef d'entreprise est mis en cause ès qualités, aucun délégataire ne peut être poursuivi. La nature intentionnelle de l'infraction autorise au contraire à rechercher la responsabilité de ce délégataire en tant que coauteur ou complice de l'infraction lorsqu'il a commis un fait personnel en relation avec celle-ci (voir notamment Cass. crim. 18 novembre 1997 : RJS 1/98 no 76 ; Cass. crim.16 septembre 2003 : RJS 1/04 no 72), mais uniquement à cette dernière condition. Il s'en déduit que contrairement à la solution qui prévaut à propos de la responsabilité des décideurs, la responsabilité pénale peut ne pas ici être alternative entre personnes physiques (sur cette question voir E. Fortis et A. Coeuret, Droit pénal du travail précité no 334).
21 Dans l'arrêt précité du 3 mars 1998, le chef d'entreprise continue de répondre du défaut de consultation du comité, qu'il ne préside plus, à propos d'une mesure entrant dans les prévisions de l'article L 432-1 du Code du travail. Dans celui du 14 octobre 2003 (Dr. soc. 2004 p 222 obs. F. Duquesne), la même solution s'attache au défaut de consultation d'un CHSCT sur un projet de travaux d'aménagement de locaux et de modification de l'outil de travail (voir également Cass. crim. 12 avril 2005 : RJS 11/05 no 1114, Dr. pén. 2005 comm. 95).
22 Cass. ass. plén. 25 février 2000 nos 97-17.378 et 97-20.152 : RJS 6/00 no 630.
23 Cass. crim. 28 mars 2006 no 05-82.975 : RJS 8-9/06 no 918.
24 Cass. ass. plén. no 00-82.066 : RJS 2/02 n 142.
25 A cet égard, on rappellera que l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal dispose que « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ». L'alinéa précédent pose qu'« il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». On retrouve là les éléments de la délégation de pouvoirs dont la validité est subordonnée au constat que le préposé est pourvu des moyens, de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur.
26 Ce depuis un arrêt de la chambre criminelle du 4 février 1898 (DP 1898, 1, 369), la qualité de complice initialement retenue laissant ensuite place à celle de coauteur (Cass. crim. 25 avril 1989 : RJS 7/89 no 656, Bull. crim. no 170).
27 Ce qui est très nettement illustré par l'affaire jugée le 23 mars 1993 (CSBP 1993 p. 185) où la chambre criminelle voit dans l'évitement des charges sociales et financières liées à l'emploi du personnel prêté par le prétendu sous-traitant le but lucratif poursuivi par la société donneuse d'ouvrage. Dans un arrêt en date du 16 mai 2000 (no 99-85.485) la chambre criminelle évoque « la poursuite d'un gain ou d'un profit » afin d'expliciter l'exigence légale du but lucratif ce qui montre la continuité du raisonnement judiciaire.
28 O. Godard, chronique de droit pénal du travail : JCP éd. E 1994 no 340 point 18. Voir également de façon plus nuancée, E. Fortis et A. Coeuret, Droit pénal du travail précité no 719).
29 Cass. crim. 4 février 1985 : Rev. sociétés 1985 p 648 note Bouloc.
30 Ainsi, dans l'affaire Deponge jugée le 15 février 1983 (JCPE 1984, II, 244 obs. Montredon), où deux sociétés avaient passé entre elles un prétendu contrat de sous-traitance relatif au nettoyage et à la maintenance chez l'entreprise cliente. Or, la société sous-traitante ne possédait ni le personnel ni le matériel nécessaires à son activité déclarée. La totalité des salariés était affectée aux mêmes tâches que ceux de l'entreprise utilisatrice. Les deux sociétés avaient en outre des dirigeants communs et une adresse unique. Il s'agissait donc d'une sous-traitance totalement simulée puisque le prévenu jouait le rôle d'un prêteur de main-d'oeuvre en même temps que celui d'utilisateur des salariés concernés.
31 Qui punit une telle violation d'un an d'emprisonnement et/ou de 45 000Euro d'amendes s'agissant des personnes physiques, la peine d'amende étant élevée au quintuple pour les personnes morales. S'y ajoute la circonstance aggravante de l'article 432-9 du même Code lorsque le fait de violation est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
32 La circulaire du 17 février 1988 sur la communication audiovisuelle énonce qu'il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes physiques ou morales déterminées et individualisées. Le tribunal de grande instance de Paris, statuant au correctionnel, a quant à lui considéré le 2 novembre 2000 que les messages électroniques revêtaient les caractères d'une correspondance privée (RJS2/01 no 166) solution confirmée par la 11e chambre de la cour d'appel de Paris, le 17 décembre 2001 (RJS 3/02 no 257). Voir également Cass. crim. 25 octobre 2000 : Bull. crim. no 317, a contrario, concernant un service de communication audiovisuelle ayant pour objet de « diffuser à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu ne peut, par définition, être personnel, Il en résulte nécessairement que les annonces ainsi émises ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance privée, tant que l'auteur de l'annonce et l'un de ses lecteurs n'ont pas décidé de consentir un dialogue ».
33 Même si l'on peut parler aujourd'hui d'une présomption de caractère professionnel des courriels d'entreprise (Cass. soc. 18 octobre 2006 : RJS 12/06 no 1241, Bull. civ. V no 308).
34 Voir à cet égard les critères dégagés par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement précité du 2 novembre 2000.
35 En ce sens la proposition de loi du 23 juin 2006 (Sénat no 385, 2006) tendant à soustraire le courrier électronique professionnel de la protection du secret des correspondances à partir de la définition suivante : « Tout courrier électronique dont le titre ou le nom du répertoire dans lequel il est archivé est relatif à l'organisation au fonctionnement ou aux activités de l'entreprise, l'administration ou l'organisme qui emploie l'expéditeur ou le destinataire dudit courrier. » (art. 1er).
36 Est réprimé : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ou d'en prendre frauduleusement connaissance. »
37 Il s'agit de la divulgation et du détournement de l'information protégée. En revanche seul l'alinéa 2 évoque l'interception alors que l'alinéa 1er vise l'ouverture du courrier. Avec Ph. Conte, on se demandera si celui (employeur ou salarié) qui prend connaissance du contenu confidentiel d'une correspondance télécommuniquée, non pas pendant son acheminement mais seulement une fois celle-ci parvenue à la connaissance de son destinataire, peut être poursuivi pénalement alors que s'il s'agissait d'un courrier matérialisé il ne le serait pas. La Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur cette relative imprécision de l'élément matériel du délit : Ph. Conte, Droit pénal spécial, Manuel Litec no 363.
38 Sur ce point, on peut à nouveau citer le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2000 en ce qu'il projette cette exigence classique sur l'hypothèse de la correspondance électronique : « L'élément intentionnel, c'est la volonté des auteurs de l'infraction de commettre des actes délictueux, volonté manifestée par le comportement de la personne qui, sachant que la correspondance en question ne lui est pas destinée, en prend néanmoins connaissance à l'issue de son destinataire. »
39 RJS 7/07 no 810 et avis de l'avocat général P. Mathon, cette même revue p. 607.
40 Sur ce point, voir le commentaire pertinent de Ph. Waquet, « Trouble objectif : le retour à la case départ » SSL 4 juin 2007 no 1310.
41 Cass. crim. 16 janvier 1992 : Gaz. Pal. 1992 som. p. 296.
42 Circonstance corroborée, il est vrai, par le fait que les envois avaient été adressés au plaignant uniquement en sa qualité de membre de l'organisme où il travaillait (CNRS), ce dernier étant le véritable destinataire.
43 On réservera en outre les hypothèses visées par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2005 laquelle autorise exceptionnellement l'ouverture de fichiers personnels en présence d'un risque ou d'un événement particulier. Si l'on considère que ce qui vaut pour les fichiers vaut également pour les courriers électroniques eux-mêmes (en ce sens l'avis précité de l'avocat général qui évoque la réception d'un virus), on y verra une manière de fait justificatif supprimant l'élément injuste de l'infraction, laquelle est par ailleurs indiscutablement caractérisée dans ses autres éléments.
44 CA Pau 24 novembre 2005, ch. appel corr. : Petites affiches 11 octobre 2006 no 203 p. 19 et s.
45 Telle est la voie tracée par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 mai 2007 : RJS 8-9/07 no 909.
46 Par opposition aux dispositions spéciales figurant dans le Code du travail.
47 CA Montpellier 5 juin 2005 no 870.
48 Arrêt confirmé par Cass. crim. 25 novembre 1997 no 96-85.670.
49 Cass. crim. 1er décembre 1992 no 89-82.689 : RJS 4/93 no 369 ; et pas seulement la conscience de transgresser la règle d'égalité de façon abstraite.
50 Pour un exemple du genre voir TGI Nantes 17 juillet 2006.
51 On rappellera que, dans le cadre de la relation de travail et sur le plan civil, cette preuve fait l'objet d'un aménagement particulier prévu à l'article L 122-45 in fine du Code du travail qui permet au salarié de se contenter de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, à charge pour l'employeur de justifier que la distinction opérée est légitime. L'intérêt des entreprises s'est donc déplacé sur le terrain de la normativité et de la légitimité des décisions comportant un élément de distinction entre les salariés. Toute la difficulté consiste à identifier la limite entre ce qui est justifiable, et peut donc être licite, et ce qui ne peut donner lieu à justification et constitue alors un fait illicite.
52 Cass. crim. 3 avril 2007 no 06-81.784 : RJS 7/07 no 870.
53 Circ. DAC 2006-16 du 26 juin 2006 : BO Ministère de la Justice no 102.
54 Cass. crim. 11 juin 2002 nos 01-85.559 et 01-85.560.
55 Circ. du 26 juin 2006 précitée. Et le ministère d'indiquer aux procureurs généraux que « les parquets ne devront pas hésiter à engager des poursuites du chef de discrimination dans les cas relevant du nouvel article 225-1 du Code pénal, dès lors que les constatations relatives à la fois au refus opposé aux vraies victimes et à l'absence de refus concernant le groupe témoin lui paraîtront avérées (que ces constatations résultent d'un constat d'huissier, d'une enquête de police ou de gendarmerie ou de procès-verbaux établis par les agents de la Haute Autorité) ».
56 Cass. crim. 27 février 1996 no 95-81.366.
57 Cass. crim. 6 février 2007 no 06-82.601 : RJS 5/07 no 622.
58 Il s'agit, d'une part, du défaut d'organisation des élections pour le renouvellement du comité d'entreprise malgré le refus de la DDTE d'en autoriser la suppression et, d'autre part, de la mise en place sans consultation des élus, d'une délégation unique du personnel, laquelle n'a même pas été réunie mensuellement.
59 Contrairement au cas de l'infraction commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction, l'article 132-2 dudit Code organisant alors la sanction du concours d'infractions » en permettant le prononcé par le juge de chacune des peines encourues sous réserve qu'elles soient de nature différente (principe du non-cumul des peines de même nature en matière correctionnelle et criminelle, article 132-7 du Code pénal).
60 Jurisprudence ancienne, voir encore Cass. crim. 16 mars 1999 : JCP E 1999 p. 2062 obs. E. Fortis. Il en va également ainsi en matière de violation des règles du repos lorsqu'un employeur ne respecte ni la règle du repos dominical ni celle du repos hebdomadaire en faisant travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, y compris le dimanche.
61 Cass. crim. 22 mai 1974 (Menzer) : Bull. crim. no 492.
62 En ce sens E. Fortis commentant le même arrêt : Rev. sc. crim. 2007 (à paraître).
63 E. Fortis précité.
64 Un rapprochement s'impose avec la norme communautaire et en particulier avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail applicable à toute personne, tant pour le secteur public que privé, dont l'article 2 prévoit que « le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination () lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er, se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ». Même si le législateur français a, par la loi de transposition de 2001, choisi de séparer formellement les notions, spécialement au niveau pénal, il ne peut échapper que le but de la règle est dans tous les cas la protection de la dignité, ce que souligne la disposition citée plus haut.
65 Rapport annuel 2006 III B - Les discriminations
dans l'emploi p. 92 et s. Selon le Président de la Haute Autorité,
parmi les évolutions marquantes il convient de relever « l'importance des réclamations portant sur le harcèlement au travail ».
Chronique parue dans le RJS 2/08
Authors:
Alain Coeuret, Of Counsel, Romain Zannou, Avocat