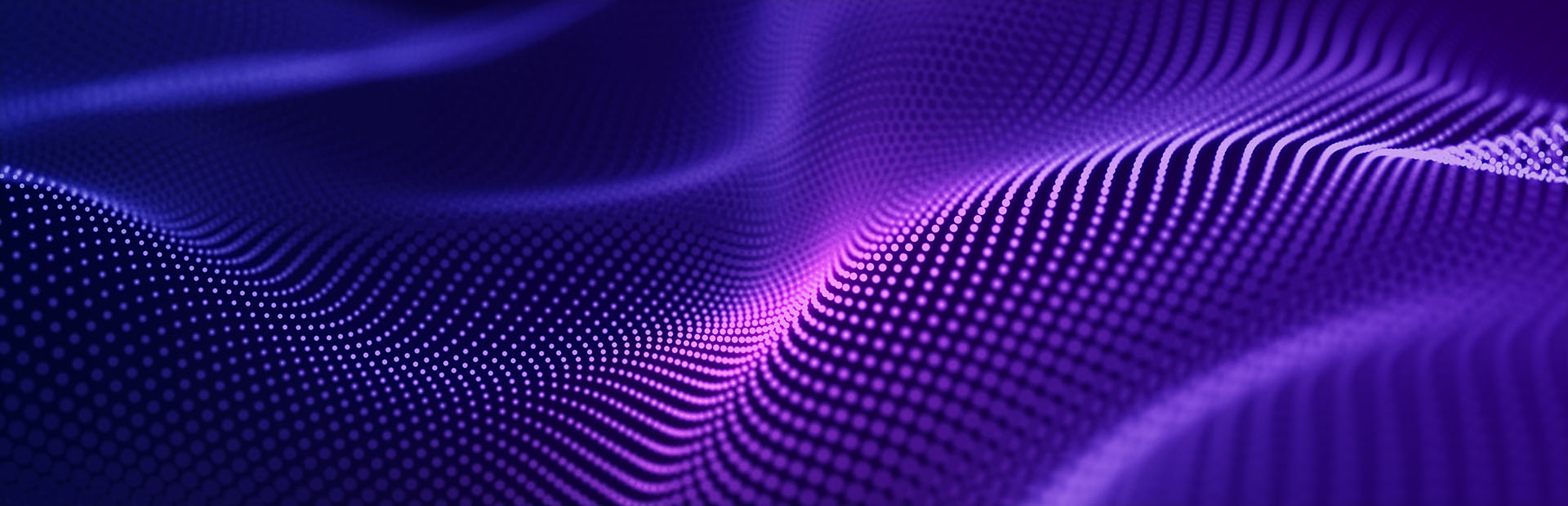Smic : Rémunération des temps de pause

Auteurs
Cass. soc. 13 juillet 2010 n° 09-42.890 (n° 1775 FS-PB), SAS La Compagnie des Fromages & Richemonts c/Isiquel & Richesmonts c/ Isiquel
L'arrêt rendu le 13 juillet 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation est le premier, à notre connaissance, à se prononcer sur la question de savoir si une prime de pause entre ou non dans le salaire à comparer au Smic (Cass. soc. 13 juillet 2010 n° 09-42.890 (n° 1775 FS-PB), SAS La Compagnie des Fromages & Richemonts c/Isiquel & Richesmonts c/ Isiquel; à paraître à la RJS 10/10).
Pour bien comprendre cette décision, il est nécessaire de l'inscrire dans le contexte des dispositions légales et réglementaires en vigueur et de la jurisprudence rendue pour son application.
Aux termes de l'article D 3231-6 (ancien article D 141-3) du Code du travail « Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ».
Ce texte a fait l'objet d'une jurisprudence abondante quant à la détermination de ce que l'on appelle communément l'assiette de calcul du Smic.
L'examen de cette jurisprudence ne peut être utilement entrepris sans que soit rappelé l'objet du Smic, tel qu'il procède notamment de l'intention même du législateur.
Objet du Smic
Aux termes de l'article L 3231-4 du Code du travail, « le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation ».
Ce texte définit clairement le Smic comme une garantie de pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs ainsi que l'a entendu la doctrine ministérielle en soulignant, dès 1950, que le salaire minimum «… n'a pas pour objet de fixer le niveau des salaires. Le minimum qu'il institue n'est pas, non plus, le point de départ de la hiérarchie ». La loi du 2 janvier 1970, qui a remplacé le Smig par le Smic, n'a pas remis en cause, bien au contraire, cette analyse. Il a été retenu à l'occasion du vote de cette loi que le Smic a pour objet de « satisfaire les besoins considérés comme élémentaires et incompressibles de la personne humaine » (JO débats AN séance du 11 décembre 1969, p. 4783). C'est au demeurant cette fonction propre qui justifie son indexation sur l'indice national des prix à la consommation.
Au strict plan des principes, on constate donc que le Smic (comme le Smig avant lui) a exclusivement une vocation alimentaire. Le professeur Jean Savatier énonce en ce sens que la garantie offerte par le Smic porte sur un pouvoir d'achat et que celui-ci est lié au revenu périodique tiré du travail accompli et susceptible d'être consommé par le travailleur pour les besoins de sa vie quotidienne. Pour lui, cette finalité du Smic doit guider l'interprète quand il s'agit de déterminer si les salariés ont reçu la rémunération minimale qui leur est garantie. Ainsi, que le revenu du travailleur provienne de son salaire de base ou de primes qui s'y ajoutent, ce qu'il faut vérifier c'est si sa rémunération globale lui procure le pouvoir d'achat garanti par la loi (J. Savatier, La portée du droit au Smic selon les modalités de rémunération : Dr. soc. 1985 p. 811 et 814). Cette analyse s'est trouvée unanimement partagée par la doctrine (en ce sens, notamment : G. Lyon-Caen, Le salaire 2e éd. Dalloz p. 38 ou G. Couturier Droit du travail, Tome 2 Relations individuelles de travail PUF 3e éd. 1996 n° 298, page 520).
Dans ce contexte, le respect des dispositions légales relatives au Smic devrait s'apprécier de façon principale par référence à la notion de pouvoir d'achat et justifier, de ce fait, la prise en compte de l'ensemble des éléments de salaire qui contribuent au pouvoir d'achat du salarié.
Principes directeurs de la jurisprudence
L'examen de la jurisprudence révèle que le juge a accueilli le principe originel de garantie du pouvoir d'achat. Plus précisément, c'est la relation entretenue entre les éléments de rémunération et le travail effectif qui détermine de façon quasi exclusive sa décision sur leur sort au regard de l'assiette de calcul du Smic. En fait comme en droit, le lien entre le salaire horaire à prendre en compte et une heure de travail effectif est donc le critère fondamental.
Rôle du temps de travail effectif
Au regard du Smic, la notion de temps de travail effectif, telle que définie à l'article L 3121-1 du Code du travail, est pertinente pour déterminer le nombre d'heures par lequel il conviendra de diviser la rémunération de référence pour apprécier si le Smic horaire a bien été respecté. Cela entraîne comme conséquence que les périodes n'ayant pas le caractère de temps de travail effectif, tels par exemple les temps de pause, doivent être déduites de ce nombre d'heures.
Mais, pour autant, les éléments de salaire à retenir pour constituer la rémunération à comparer au Smic ne sont pas exclusivement ceux venant rémunérer stricto sensu les temps de travail effectif. En d'autres termes, la référence au temps de travail effectif vaut uniquement pour déterminer le dénominateur de l'opération servant au calcul de la rémunération horaire (soit le rapport du temps de travail à la rémunération).
La jurisprudence admet en effet que des éléments de salaire qui ne rémunèrent aucun temps de travail effectif soient pris en compte dans l'assiette de calcul du Smic, ainsi que le montrent notamment les exemples cités n° 19. Pour qu'un élément de rémunération entre dans l'assiette de calcul du Smic, il suffit qu'il ait la nature d'un complément de salaire en relation avec le temps de travail effectif, c'est-à-dire qu'il soit en relation, par un lien suffisant, avec le travail effectif accompli, sans pour autant constituer nécessairement la rémunération d'un temps de travail effectif.
Cette distinction a été illustrée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt ayant admis l'inclusion dans l'assiette du Smic de sommes versées à titre d'indemnisation de l'amplitude de la journée de travail par une entreprise de transports routiers au motif qu'elles avaient le caractère de fait d'un complément de salaire. A été rejeté le moyen du pourvoi selon lequel « l'indemnité compensatrice de l'amplitude de la journée de travail ne rémunère pas un travail effectif, mais est destinée à indemniser le salarié pour le temps de la journée de travail qui dépasse le temps du travail effectif ; qu'ainsi, n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant pas un complément de salaire, elle ne doit pas être prise en compte pour rechercher si le Smic a été perçu » (Cass. crim. 18 juillet 1991 n° 89-83.128 : RJS 10/91 n° 1155).
Lien avec le travail effectif
Pour déterminer, dans chaque cas d'espèce, la nature du lien devant être établi entre les rémunérations versées et le travail effectif, la jurisprudence distingue :
- d'une part, les éléments de salaire qui doivent être exclus pour apprécier le respect des règles légales relatives au Smic, dans la mesure où ils n'ont pas une relation suffisante avec le travail effectif accompli par le salarié ;
- et, d'autre part, les éléments de salaire, qui, sans nécessairement constituer la rémunération du temps de travail effectif, sont en relation directe avec le travail effectif accompli par le salarié et constituent à ce titre un salaire ou un complément de salaire, au sens de l'article D 3231-6 du Code du travail, à prendre en compte pour apprécier si le montant du Smic est atteint.
Cette distinction procède des termes mêmes de l'article D 3231-6 du Code du travail, selon lesquels la rémunération à retenir est celle qui « correspond » au temps de travail effectif, et non la rémunération du temps de travail effectif, ce par la prise en compte des « majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ».
L'existence d'un lien suffisant entre l'élément de rémunération en cause et le temps de travail effectif est donc la condition nécessaire mais suffisante de son incorporation dans l'assiette du Smic.
Cette règle a conduit le juge à écarter du salaire à comparer au Smic, outre les éléments expressément exclus par l'article D 3231-6 du Code du travail (remboursements de frais, majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, prime de transport), certains éléments de rémunération en raison de leur absence de lien suffisant avec le travail effectif.
Exemples d'éléments de rémunération sans lien suffisant avec le travail effectif
L'exemple des primes d'ancienneté et d'assiduité est éclairant. Les primes d'ancienneté sont exclues car elles sont liées à la stabilité des salariés au sein de l'entreprise et non liées à la rémunération d'un travail effectif (en ce sens, notamment : Cass. crim. 27 janvier 1987 n° 84-95.098). La solution a été depuis lors confirmée par de nombreux arrêts (Cass. soc. 23 avril 1997 n° 94-41.701 ; Cass. soc. 19 juin 1996 n° 93-45.958 ; Cass. soc. 24 février 1993 n° 89-45.840 ; Cass. soc. 12 novembre 1992 n° 89-45.090 : RJS 12/92 n° 1385 ; Cass. crim. 29 novembre 1988 n° 87-80.086 ; Cass. crim. 3 janvier 1986 n° 84-95.123). Pour les mêmes raisons, il en est de même des primes d'assiduité (Cass. crim. 27 janvier 1987 n° 84-95.098 ; Cass. soc. 23 avril 1997 n° 94-41.701 ; Cass. soc. 19 juin 1996 n° 93-45.958 ; Cass. soc. 12 novembre 1992 n° 89-45.090 : RJS 12/92 n° 1385).
Les primes liées à des conditions particulières de travail, telles celles destinées à indemniser des sujétions particulières (prime de froid, d'insalubrité, d'insécurité, etc.) sont également écartées au motif d'une relation identiquement distendue avec le temps de travail effectif (Cass. soc. 3 juillet 2001, n° 99-458 ; Cass. soc. 24 novembre 2004 n° 02-44.488 ; Cass. soc. 13 octobre 2004 n° 02-44.650 ; Cass. soc. 11 juillet 2006, n° 05-41177).
L'exclusion est également de règle pour les primes collectives de rendement et de résultats liées à des facteurs généraux, comme la production globale de l'entreprise ou de l'établissement, à sa productivité ou à sa prospérité, sans relation suffisamment directe avec le temps de travail effectif accompli par le salarié. Ainsi jugé, par exemple, pour une prime de résultat dont il a été relevé, pour l'exclure, qu'elle n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié mais était au contraire fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, de sorte notamment qu'elle était susceptible d'être suspendue ou supprimée en cas de mauvais résultats (Cass. soc. 7 avril 2004 n° 02-41.616 ; dans le même sens : Cass. soc. 2 avril 2003 n° 01-41.852 ; 00-46.319 et 00-46.320 : RJS 6/03 n° 742 ; Cass. crim. 5 novembre 1996 n° 95-82.994 : RJS 2/97 n° 14).
La doctrine du ministère du travail est en harmonie avec cette jurisprudence. Pour mémoire, la circulaire du 23 septembre 1950 et la circulaire DRT n° 3 du 29 juillet 1981 se sont référées aux conditions particulières de travail et aux sujétions supplémentaires qui en découlent pour les salariés.
Exemples d'éléments de rémunération en relation avec le travail effectif
Il résulte de l'article D 3231-6 (ancien article D 141-3) du Code du travail que doivent être prises en compte, outre les avantages en nature, les « majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ».
L'examen de la jurisprudence conduit à constater que cette dernière notion recouvre l'ensemble des sommes qui sont « en relation avec le travail effectif » accompli par le salarié. Selon la doctrine, « le salaire à prendre en considération est alors celui effectivement perçu pour une heure de travail » (G. Lyon-Caen, Le salaire 2e édition Dalloz p. 38). « Quels sont les éléments de rémunération qui doivent entrer en compte ? Certainement les avantages en nature qui font, à cette fin, l'objet d'une évaluation forfaitaire et, en général, toutes les primes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail » (G. Couturier, Droit du travail, tome 2 Relations individuelles de travail PUF 3e éd. 1996 n° 298 p. 520).
Nombreux sont les exemples qui pourraient être cités pour illustrer la jurisprudence incluant dans l'assiette de calcul du Smic les éléments de rémunération versée en relation avec le travail effectif.
A la différence des primes collectives de rendement, dont le versement ne dépend pas de l'activité du seul salarié (ce qui justifie leur exclusion à raison de l'opposition entre facteurs généraux et facteurs personnels), les primes individuelles de résultat doivent être prises en compte pour vérifier si le montant du Smic est atteint. Elles sont, en effet, en relation avec le travail effectif du salarié. Ainsi jugé que les commissions versées au salarié en contrepartie de son activité personnelle doivent être prises en compte (Cass. soc. 20 novembre 2001 n° 99-44.086). Même solution pour les gueltes, peu important leur caractère aléatoire dépendant des ventes effectuées (Cass. soc. 30 mars 1994 n° 92-40.531 : RJS 5/94 n° 553) ou la « prime d'hôtesse enquêtrice », versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail (Cass. soc. 13 mars 1990 n° 87-41.726).
Il en est de même des primes de vacances et de fin d'année. Elles sont en effet indiscutablement perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli (Cass. soc. 2 mars 1994 n° 89-45.881 : RJS 4/94 n° 412 ; Cass. crim. 29 novembre 1988 n° 86-92.449 : RJS 1/89 n° 21) ; Cass. soc. 17 mars 1988 n° 85-41.930).
Pour l'application de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, il a été jugé qu'une prime à valoir sur les effets à venir des nouvelles classifications jusqu'à la date de leur mise en application constitue un acompte sur celles-ci ou donne des points supplémentaires à l'occasion du travail, ce qui justifie leur inclusion dans le Smic (Cass. soc. 2 juin 1999 n° 97-45.739. Solution confirmée par Cass. soc. 28 janvier 2004 n° 02-43.701 à 02-43.706 ; 4 février 2003 n° 00-45.277 : RJS 4/03 n° 462 ; 4 juillet 2001 n° 99-42.603 et 24 novembre 1998 n° 97-43.728 à 97-43.732 : RJS 1/99 n° 40).
Cas de la rémunération des temps de pause
C'est dans ce contexte jurisprudentiel, dont les principes essentiels apparaissent ainsi lisiblement, qu'a été rendu l'arrêt du 13 juillet 2010, Compagnie des fromages & Richesmonts. Cet arrêt mérite des observations circonstanciées, car la Cour de cassation n'avait encore jamais eu, à notre connaissance, à se pencher sur le sort des éléments de rémunération attachés aux temps de pause.
L'arrêt n'est en rien novateur quant au contrôle de la qualification juridique des faits au regard de la définition légale du temps de travail effectif. La Cour précise en effet : « Il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas un temps de travail effectif ». Cette assertion n'appelle aucune observation au regard de l'article L 3121-1 du Code du travail définissant le temps de travail effectif.
Si les faits avaient conduit à qualifier les temps de pause de temps de travail effectif, leur rémunération aurait été par principe incorporée dans l'assiette de calcul du Smic. Mais puisqu'il n'avait pas procédé à un tel constat, le juge devait déterminer si les conditions pour qu'un élément de salaire qui ne rémunère pas stricto sensu le temps de travail effectif soit pris en compte dans l'assiette de calcul du Smic étaient réunies. A cet égard, la Cour de cassation a retenu une formulation qui commande un examen attentif tant au regard du particularisme des faits de l'espèce que des principes jurisprudentiels. Selon l'attendu : « Les primes les rémunérant [les pauses], qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au Smic ».
Au cas particulier, les primes de pause s'inscrivaient dans un contexte conventionnel très particulier, d'ailleurs relevé par le juge du fond. Elles résultaient en effet d'un accord collectif d'aménagement-réduction du temps de travail, conclu le 18 janvier 2001 (et modifié par voie d'avenant le 26 novembre 2004). Cet accord poursuivait, selon ses propres termes, deux objectifs : le maintien de la rémunération malgré une diminution du temps de travail et le maintien du taux horaire en vigueur.
A cet égard, la cour d'appel a relevé que « la prime de pause ne remplit aucun des deux objectifs annoncés par l'accord ». Si cette occurrence ne peut être considérée comme déterminant la solution du litige, il est en revanche certain que la prime en cause était, tant dans son principe que dans la fixation de son montant, sans relation aucune avec le temps de travail effectif.
A son tour, la Cour de cassation a pris acte, au cas particulier, de l'absence de relation de la prime de pause avec le temps de travail effectif et a considéré qu'elle dépendait de « facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas ».
Ayant fait la même analyse, la cour d'appel avait caractérisé ces facteurs généraux par une référence aux dispositions légales que suggérait la durée de cette pause, fixée à 20 minutes. On sait que l'article L 3121-33 du Code du travail impose d'accorder aux salariés une pause d'au moins 20 minutes chaque fois que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Elle en avait notamment déduit que l'employeur, en rémunérant forfaitairement une pause de 20 minutes, avait rémunéré un « temps imposé et déterminé par une disposition légale, sur lequel le salarié n'influe pas », ce qui devait conduire à une exclusion du salaire de comparaison avec le Smic.
Le critère d'exclusion tiré de la référence à des facteurs généraux invoqué ici par le juge du fond et repris par la Haute Cour n'est pas nouveau. La Cour de cassation y avait déjà eu recours, sous une terminologie ou une autre. Ainsi, par l'arrêt du 5 novembre 1996 cité n° 14, elle a écarté une prime « n'étant pas fonction de la prestation de travail personnel de chaque salarié » et dépendant « de facteurs sur lesquels les salariés n'avaient pas d'influence directe » (la référence au lien de l'élément de rémunération avec la prestation de travail personnel du salarié a été ultérieurement reprise par la Cour de Cassation, notamment : Cass. soc. 2 avril 2003, n° 00-46319 et Cass. soc, 7 avril 2004, n° 02-41616). A cet égard, la motivation de l'arrêt du 13 juillet 2010 ne heurte nullement, bien au contraire, les principes jurisprudentiels rappelés plus haut.
Cette motivation est en harmonie avec la doctrine. A titre d'exemple, pour le professeur Jean Savatier, « le salaire minimum est en principe une créance proportionnelle au temps de travail accompli par l'intéressé », précisant que les sommes à intégrer à l'assiette du Smic « portent sur un pourcentage du salaire de base mensuel » (Les minima de salaire : Dr. soc. 1997 p. 577). Messieurs Alain Supiot, Jean Pelissier et Antoine Jeammaud font, a contrario, la même analyse, écartant les sommes correspondant à des exigences périphériques à la prestation de travail et indépendantes du temps de travail effectif (Droit du travail : Dalloz éd. 2008 n° 749).
En conclusion, l'arrêt Compagnie des Fromages & Richesmonts du 13 juillet 2010 n'autorise en aucune façon à prétendre, en l'état actuel du droit, que tout élément de rémunération d'une pause doit être exclu, par principe, de l'assiette de calcul du Smic.
Bien au contraire, il invite à un examen de chaque régime dont procède le paiement d'une pause. Rien ne permettrait, en effet, à bon droit d'exclure de l'assiette du Smic un complément de salaire dont la détermination correspondrait, selon les prévisions mêmes de l'article D 3231-6 du Code du travail, au temps de travail effectif comme étant en stricte relation avec celui-ci.
Cette lecture de l'arrêt est conforme à la vocation originelle du Smic, rappelée ci-dessus n° 3 s., qui est d'accorder à chaque salarié une garantie de pouvoir d'achat à raison de sa prestation de travail personnel.
Article paru dans La revue Editions Francis Lefebvre | Feuillet Rapide Social n° 15/10 - 20 août 2010
Par Laurent Marquet de Vasselot, avocat Associé, CMS Bureau Francis Lefebvre et Alain Cœuret, Agrégé des facultés de Droit - Ancien Conseiller à la Cour de cassation