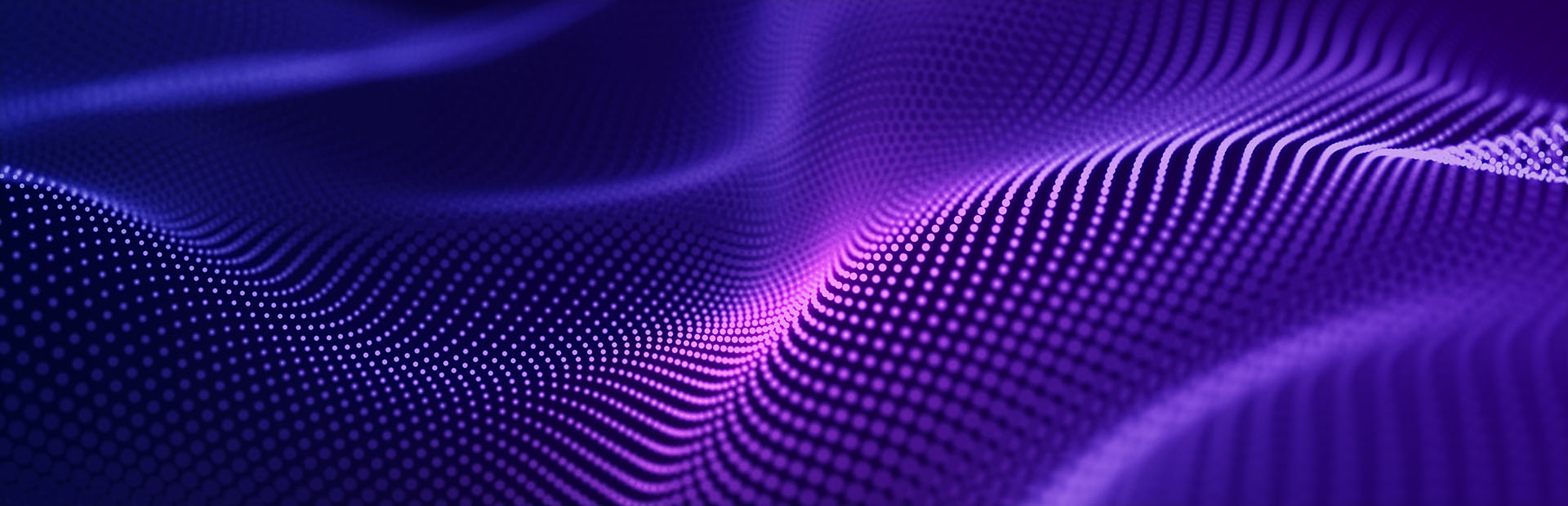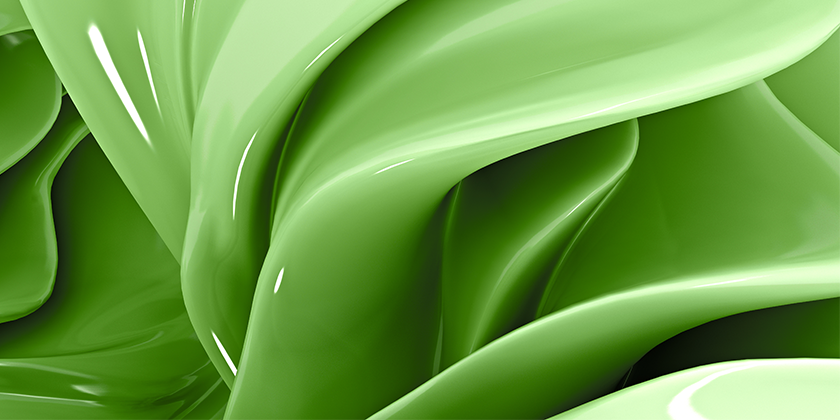Le Conseil d’Etat juge que le critère d’imposition minimale du prêteur est à analyser au niveau de son associé contrôlant, même s’il s’agit d’une personne physique, en cas de société prêteuse fiscalement translucide.
Dans un arrêt en date du 31 mai 2024, n° 476479, sté Les Vignobles Réunies-Roullet, le Conseil d’Etat juge que pour l’application du dispositif dit « hybrides » aux termes duquel, selon sa rédaction en vigueur jusqu’en 2019, la déduction des intérêts payés entre entreprises liées requérait une imposition minimale chez le prêteur du quart de l’impôt français, ladite imposition minimale doit être appréciée au niveau de l’associé contrôlant si le prêteur est une société fiscalement translucide. S’il s’agit comme dans l’espèce jugée d’une personne physique, l’analyse doit être réalisée à son niveau, peu importe son implication effective dans la société prêteuse. La décision, d’une portée désormais historique avec la substitution d’un nouveau texte à celui à l’époque en vigueur, peut tout de même poser la question de sa portée actuelle.
L’imposition minimum du prêteur s’applique au niveau de l’associé contrôlant de la société translucide prêteuse, quelle que soit sa nature
Avant sa remise en cause par la loi de finances pour 2020, l’article 212 du Code général des impôts prévoyait en substance que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée étaient déductibles, entre autres conditions, sous réserve que la société débitrice démontre que le prêteur était assujetti à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant était au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices, déterminé dans les conditions de droit commun, au taux normal de l’impôt sur les sociétés français.
L’article prévoyait qu’en cas d'entreprise prêteuse établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal en vigueur devait s'entendre de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
Enfin, le dispositif prévoyait que lorsque l'entreprise prêteuse était une société ou un groupement fiscalement translucide ou un organisme de placement collectif réglementé, français ou étranger, ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui n'était pas un Etat non coopératif, la restriction à la déduction ne s'appliquait que s'il existait également des liens de dépendance entre cette entité et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette entité. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts devait être apprécié au niveau de ces détenteurs de parts.
En clair, dans l’hypothèse d’un prêteur étranger translucide fiscalement, les intérêts n’étaient pas déductibles lorsque existait un lien de dépendance non seulement entre le prêteur et l’emprunteur mais aussi, en deuxième lieu, entre le prêteur et son associé, ce dernier ne satisfaisant pas le critère d’imposition minimale exigé par l’ancien article 212 du CGI.
Or, dans les faits de l’espèce, l’entreprise prêteuse était un Limited Liability Partnership, soit une société translucide de droit britannique, dont l’actionnaire contrôlant était une personne physique résidente fiscale russe.
Partant, la question pouvait légitimement se poser de savoir si le dispositif allait jusqu’à prévoir qu’une telle personne devait être prise en compte pour satisfaire ou non le critère de niveau imposition requis : s’agissant d’un particulier, une comparaison d’impôt sur les sociétés ne faisait en effet que peu de sens, de la même manière que les dispositions de l’article 39-12 du CGI portant sur les liens de dépendance visées par ledit dispositif ne s’appliquent à la lettre dudit texte qu’à des entreprises.
Ces arguments n’étaient pas dépourvus de pertinence et il pouvait être légitime de considérer que le texte en l’état ne visait que des relations entre sociétés. Une telle acception aurait sans doute pu être retenue au regard d’un dispositif dont la portée était déjà très large, le cantonnant ainsi aux relations purement interentreprises.
Ils n’ont toutefois pas été retenus par le Conseil d’Etat qui a pris le soin de se fonder sur les dispositions de l’article 212 du CGI telles qu'éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi de finances du 29 décembre 2013 pour 2014. La haute juridiction juge alors que la déductibilité des intérêts de prêts entre entreprises (donc liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI) est, dans l'hypothèse où seuls les associés du prêteur sont assujettis à l'impôt à raison des bénéfices que ce dernier réalise, subordonnée à la preuve d'un niveau minimal d'imposition de l'associé sur ces intérêts, dès lors que ce dernier entretient avec le prêteur un lien de dépendance.
La décision est sans équivoque : dans un tel cas de figure, le niveau minimal d'imposition sur les intérêts versés doit être apprécié au niveau de la personne physique détentrice de 99 % des parts de cette dernière, sans qu’il ne soit d’ailleurs besoin de rechercher si cette détention constitue pour elle une activité économique ou professionnelle. Ce dernier argument, tendant à exclure les investisseurs passifs comme ne pouvant être assimilés, d’une certaine manière, à une « entreprise » n’a pas non plus porté. L’actionnaire personne physique aura beau avoir effectué un investissement par hypothèse totalement passif dans une entité translucide, c’est bien son imposition personnelle qui devra être prise en compte. Si elle s’avère inférieure au quart de l’impôt qui aurait été dû si lesdits revenus avaient été imposables en France, le dispositif a lieu de s’appliquer. L’ampleur des termes employés dans le texte de l’époque (« impôt sur les bénéfices », « impôt sur le revenu ou sur les sociétés », « détenteurs de part ») aura permis de conduire à cette conclusion extensive.
Ainsi, comme le rappelle le Rapporteur public Romain Victor, dans ses conclusions lues à l’audience sous l’arrêt en question, il s’agissait avant tout d’un dispositif anti-abus (éviter une double déduction inappropriée) pour lequel l’intention du législateur était bien d’aller rechercher « les personnes effectivement soumises à l’impôt » (d’après les propos de Christian Eckert, rapporteur général de ladite loi), peu importe leur nature.
Il n’est donc pas inintéressant de souligner que le Conseil d’Etat, qui avait affaire à un texte facialement imparfait, s’est fortement appuyé sur les débats parlementaires ayant conduit à son adoption pour rendre sa décision. La haute juridiction se fonde sur la raison d’être de la loi, « telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé [son] adoption » pour refuser toute exception à son principe général visant à éviter une déduction chez l’emprunteur et une faible ou inexistante imposition chez le prêteur ou son associé.
Quelle portée pour demain ?
Compte tenu de la substitution de textes depuis 2020, la question qui se pose est celle de savoir si cet arrêt a un impact effectif sur le dispositif anti-hybrides actuel, assez différent de l’ancien dans son approche de la double déduction.
En substance, le nouveau texte (codifié aux article 205 B et suivants du CGI) prévoit que des règles particulières s'appliquent afin de neutraliser les effets fiscaux asymétriques causés par certains dispositifs résultant de différences entre la législation française et celle d'autres États au regard soit de la qualification de certains instruments financiers et/ou entités, soit de l'attribution des paiements (déduction dans un État et absence d'inclusion dans le résultat imposable dans un autre État ou double déduction).
C’est désormais et avant tout la notion de « débiteur » et de « bénéficiaire » qui prévalent et non plus celle « d’entreprises ». Cela observé, la question d’une société prêteuse translucide doit rester pertinente, les cas de figure d’hybrides étant variés, quand bien même limitativement énumérés. Mais le texte lui-même parait silencieux sur cet aspect précis.
Pour tenter, à ce stade, de pallier ce silence, on retiendra deux précisions de la doctrine administrative sur le sujet :
En premier lieu, elle indique que « Le fait que le résultat dans lequel le paiement a été inclus soit imposé à un taux plus faible que le taux normal de l'impôt sur les sociétés de l'État de résidence du bénéficiaire, ou même exonéré d'impôt sur les sociétés en application de la législation de cet État, ne conduit pas à remettre en cause l'existence d'une inclusion » (BOI-IS-BASE-80-10 n° 80, 9-2-2022). Le changement de paradigme est donc bien acté par les autorités administratives.
En second lieu, elle précise que les nouvelles dispositions « s'appliquent à toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à celles imposables dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI dès lors qu'un associé est soumis à l'impôt sur les sociétés » (idem, n° 1).
Article paru dans Option Finance le 25/06/2024
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

|

|

|