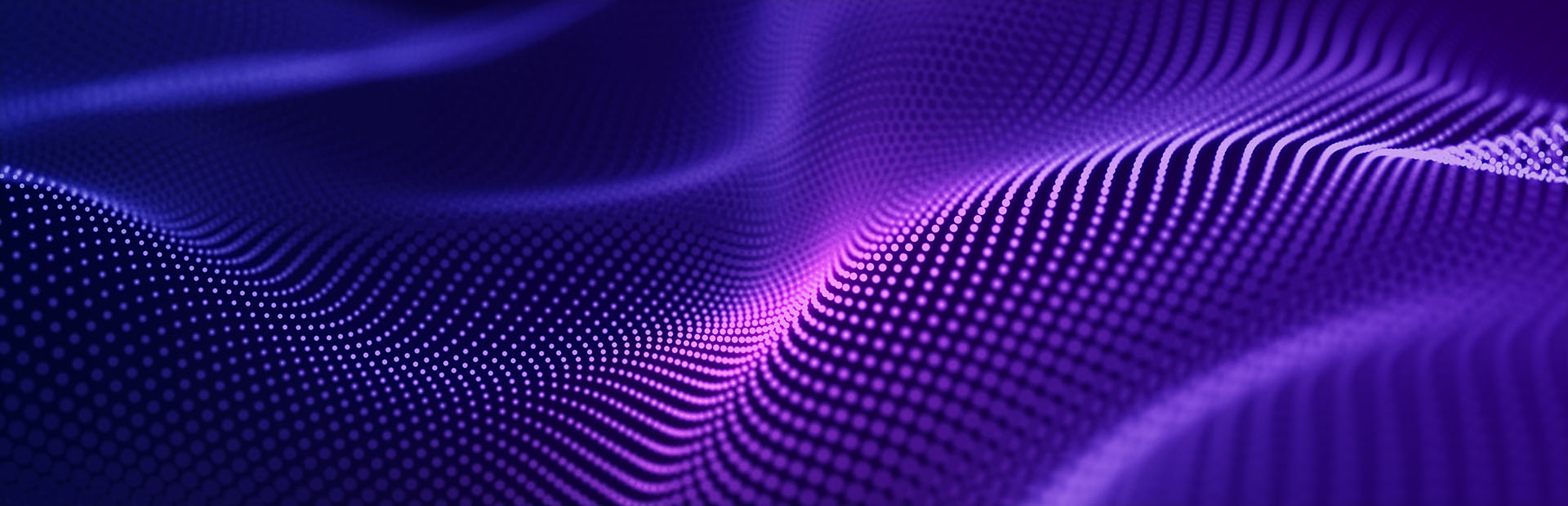La Cour de cassation vient de rendre une décision riche en enseignements sur les risques liés à un refus de la transaction proposée par le ministre dans le cadre de micro-pacs et la qualification des échanges d’informations confidentielles intervenus lors d’un appel d’offres (Cass. com. 24 septembre 2025 n° 23-13.733).
Une pratique anticoncurrentielle lors d’un appel d’offres
Une communauté urbaine lance un appel d'offres pour la gestion technique de ses bâtiments ; celui-ci autorise le recours partiel à la sous-traitance. Deux sociétés concurrentes soumissionnent chacune, l’une en présentant une offre comportant deux options : la première prévoit sa candidature individuelle, la seconde une candidature multiple comportant son intervention et celle d’un sous-traitant, lequel n’est autre que l’autre soumissionnaire.
Estimant que l'échange d'informations intervenu entre les deux sociétés soumissionnaires lors de l'élaboration de l'offre litigieuse constituait une pratique anticoncurrentielle, le ministre de l’Économie avait engagé, en application de l'article L. 464-9 du Code de commerce, une procédure d'injonction et de transaction que la société auteur de l’offre avait refusée.
Saisie par le ministre, à la suite de ce refus, l’Autorité de la concurrence avait condamné la société soumissionnaire mais aussi ses sociétés mères pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à des échanges d'informations confidentielles en vue de la passation du marché public. Cette décision avait été confirmée par la Cour d’appel de Paris.
Devant la Cour de cassation, les entreprises condamnées contestaient à la fois la possibilité pour l’ADLC de condamner les sociétés mères de la soumissionnaire alors qu’elles n’étaient pas dans la transaction et l’existence même d’un échange d’informations confidentielles illicites lors de la soumission litigieuse.
Les conséquences d’un refus de transaction et la liberté de l’ADLC
Lorsque l’ADLC ne se saisit pas de pratiques anticoncurrentielles, le ministre de l’Economie peut enjoindre aux entreprises qui en sont l’auteur d’y mettre un terme et leur proposer de transiger, sous réserve que ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 TFUE (c-à-d ne sont pas susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres) et que le chiffre d'affaires réalisé par chacune en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité pour les mêmes faits. En cas de refus de transiger, le ministre saisit l'Autorité de la concurrence (art. L. 464-9 C. com.).
Les entreprises condamnées estimaient que, contrairement au cas où elle est saisie par le ministre sur le fondement de l'article L. 462-5, I du Code de commerce, l’ADLC ne dispose pas, lorsqu’elle intervient après un refus de transiger avec le ministre (art. L. 464-9 C. com.), d’une liberté totale pour apprécier et qualifier les faits de l'espèce ainsi que pour déterminer les personnes auxquelles l'infraction peut être imputée. Dans ce cas, elle serait liée par les analyses ou qualifications envisagées au cours de la phase administrative antérieure pour identifier les auteurs de la pratique, ce qui lui interdirait d'imputer pour la première fois l'infraction aux sociétés mères de la société seule mise en cause par le ministre.
La Cour de cassation rejette l’argument. Elle énonce qu’en cas de refus de transiger, l'Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d'imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement.
Les choses sont claires pour l’ADLC : ou la transaction est acceptée et aucune autre société que celles identifiées par le ministre ne peut être ultérieurement poursuivie par l’ADLC pour les mêmes faits ; ou la transaction est refusée et cet échec est sans incidence sur la suite de la procédure devant l’ADLC qui est saisie in rem ici aussi. Cette dernière n’est pas liée par la décision antérieure du ministre ; elle peut décider librement, comme dans le cadre de la procédure de l’article L. 462-5, I C. com., des sociétés auxquelles sera imputée la pratique anticoncurrentielle litigieuse.
Les choses doivent l’être aussi pour les groupes de sociétés : refuser la transaction pour une filiale non autonome n’est pas sans risque ; son refus pourra se traduire par une extension du périmètre de l’entreprise à laquelle la sanction sera infligée pour englober également sa société mère et avec celle-ci le chiffre d’affaires du groupe. En d’autres termes, du ministre à l’ADLC, le périmètre de l’entreprise condamnée et l’assiette de la sanction peuvent sensiblement s’étendre.
A noter : En l’espèce, le ministre n’aurait pas pu inclure les sociétés mères dans le périmètre de la transaction car, même si la filiale n’était pas autonome, le chiffres d’affaires du groupe dépassait le seuil au-delà duquel il n’est plus compétent pour se saisir de la pratique. La Cour de cassation a estimé que le fait pour le ministre de ne pas avoir décliné sa compétence, alors qu’il avait constaté l’existence d’une entreprise entre la filiale et ses sociétés mères, n’était pas de nature à entraîner l'irrégularité de la saisine de l'Autorité en cas de refus de la filiale de transiger.
L’interdiction des échanges d’informations entre les soumissionnaires
Un autre point contesté de la décision portait sur l’existence d’un échange d’informations confidentielles, lors de la soumission des offres, qualifié par l’ADLC de pratique anticoncurrentielle par objet.
Les entreprises condamnées soutenaient que la sous-traitance qui conduit nécessairement à un échange d’informations n'est pas en soi anticoncurrentielle et ne le devient que si elle s'accompagne d'agissements destinés à tromper l'acheteur public sur la réalité de la concurrence entre les entreprises, ce qui selon elles n’avait pas été le cas en l’espèce.
Après avoir rappelé la jurisprudence européenne, la Cour de cassation rejette ici aussi l’argument et approuve le raisonnement suivi par la Cour d’appel.
La faculté pour une entreprise de proposer une offre en coopération avec une autre, afin de s'adjoindre des compétences dont elle ne dispose pas en interne, n'est pas illicite en soi. Elle peut même avoir des effets pro-concurrentiels si elle permet à ces entreprises de concourir alors qu'elles n'auraient pas été capables de le faire isolément ou si elle leur permet de le faire sur la base d'une offre plus compétitive ou de meilleure qualité. Mais, une telle coopération ne peut pas pour autant s’affranchir du respect des règles de concurrence et ne doit pas fausser le libre jeu de la concurrence qui doit s'exercer sur le marché pertinent, chaque offre déposée devant être élaborée en toute indépendance.
Or, les échanges entre les deux soumissionnaires à la suite du lancement de l’appel d’offres avaient permis à la société mise en cause d'avoir accès à l'offre financière et au mémoire technique que sa concurrente avait élaborés pour répondre à l’appel d'offres. Ces échanges étant intervenus avant que les deux sociétés soumissionnaires procèdent, chacune à titre individuel, au dépôt de leur offre, ils avaient servi à l'élaboration de l'offre de la société condamnée.
Par ailleurs, dans son mémoire technique la société mise en cause avait fait usage du logo de sa concurrente, ce qui induisait une référence ambiguë au recours éventuel à la sous-traitance dans l'hypothèse du choix par l'adjudicateur de sa candidature individuelle. L'information du maître de l'ouvrage ne pouvait donc être regardée comme explicite et non ambiguë.
La Cour en a déduit que le dépôt de deux dossiers de candidature séparés par les deux sociétés soumissionnaires, incluant en apparence des offres indépendantes, avait nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître de l'ouvrage sur l'intensité de celle qui s'était exercée lors de l'appel d'offres.
Les informations échangées étant donc allées au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance, la pratique incriminée constituait bien une restriction de concurrence par objet.
Cette décision est l’occasion de rappeler que, si la coopération entre entreprises concurrentes (et notamment le choix d’un autre soumissionnaire comme sous-traitant après l’attribution du marché) n’est pas interdite, la prudence impose en revanche de veiller à la nature des informations susceptibles d’être échangées entre les soumissionnaires lors de l’élaboration des réponses à un appel d’offres. Le conseil vaut d’une manière générale pour tous les échanges d’informations entre concurrents. Au risque de tomber sous le coup de l’interdiction des ententes !