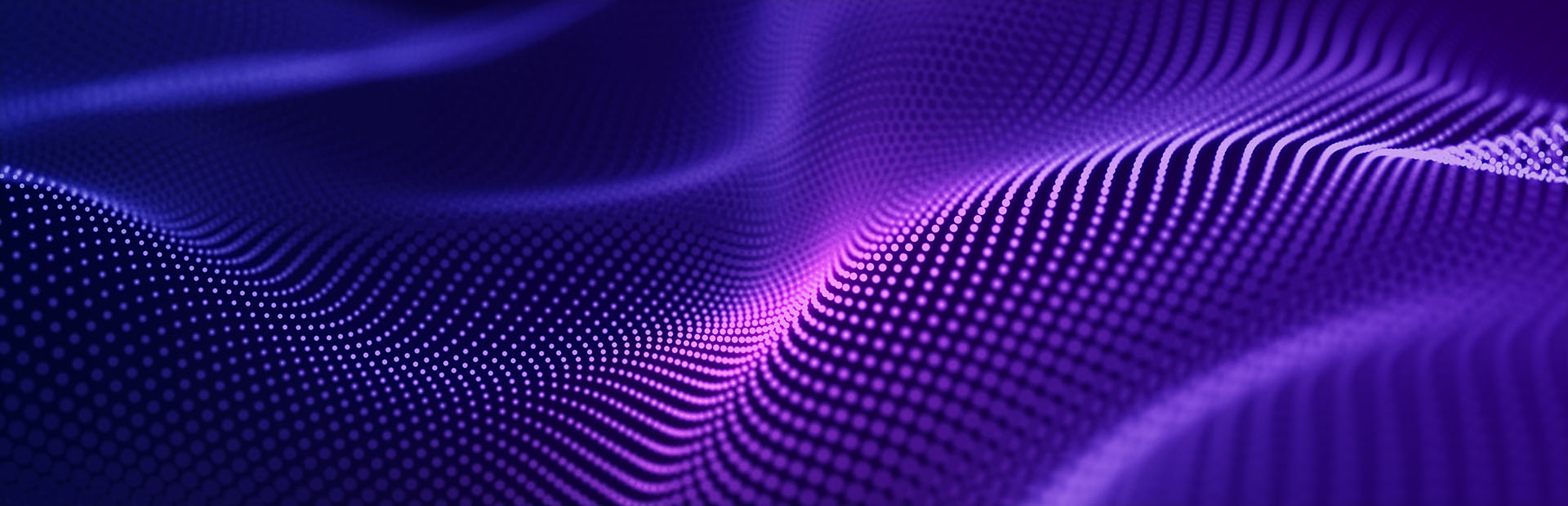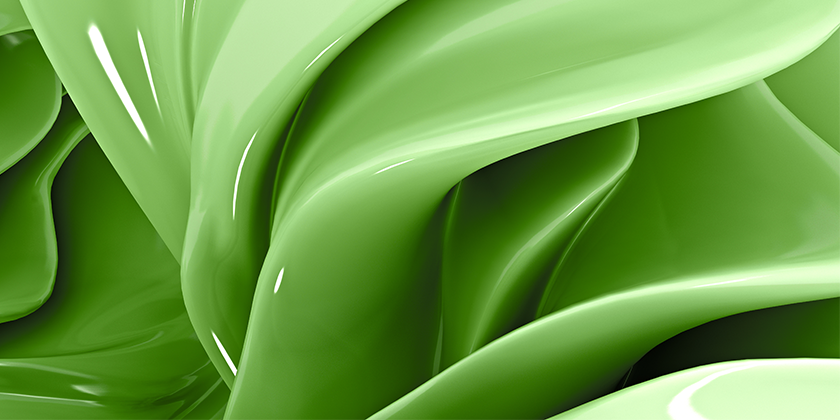.jpg?v=1)
La décision Fibusa apporte des clarifications quant à la répartition de la charge de la preuve entre l’administration fiscale et le contribuable dans le cadre de la définition du taux d’intérêt applicable à des avances non rémunérées accordées à des filiales étrangères. A ce titre, des précisions sont apportées par le Conseil d’Etat en matière de prix de transfert.
La société holding de droit français Fibusa a consenti, de 2011 à 2014, à quatre de ses filiales roumaines des prêts sans intérêt, d’une maturité inférieure à un an, renouvelables pour la même durée et incluant la possibilité de procéder à des remboursements anticipés.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a considéré que la renonciation à percevoir des intérêts en contrepartie des avances consenties était constitutive d’un avantage par nature entraînant de ce fait une présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du Code Général des Impôts.
Sur ce fondement, l’administration fiscale a réintégré aux résultats de la société les intérêts non perçus qui ont été déterminés sur la base des taux d’intérêts qui lui étaient appliqués au titre des sommes qu’elle avait empruntées pour financer les avances intragroupe accordées aux filiales roumaines sur la période considérée.
En désaccord avec cette position, la société a saisi le Tribunal administratif de Pau (TA, 17 décembre 2020, n°1800672) qui a validé la position de l’administration fiscale. La cour administrative d’appel de Bordeaux (CA, 22 novembre 2022, n°21BX00968) a maintenu le principe des rehaussements proposés mais en opérant une distinction entre les modes de financements utilisés par la société ce qui a conduit à une décharge partielle du montant des impositions en litige sur la quote-part correspondant aux montants des avances financées via des fonds propres. Le ministre se pourvoit en cassation auprès du Conseil d’Etat (CE, 20 décembre 2024, n°470557) qui casse la décision de la cour administrative d’appel.
Dans le cadre de ses développements, la société a dans un premier temps apporté des éléments visant à apporter la preuve que les avances sans intérêt accordées étaient justifiées par l’obtention de contrepartie (1) avant de contester le taux d’intérêt appliqué par l’administration fiscale pour déterminer le montant des intérêts non perçus (2).
1. Concernant l’existence d’une contrepartie aux avances consenties sans intérêt
La présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger liée à l’existence d’un avantage par nature ne peut utilement être combattue par le contribuable que si celui-ci apporte la preuve que les avantages qu’il a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
En ce sens, la société a tenté de démontrer qu’elle avait un intérêt propre à ne pas exiger, de la part de ses filiales roumaines, le versement d’intérêts en argumentant de sa volonté de ne pas dégrader leur situation financière pour, le cas échéant, être rémunérée par des dividendes.
Toutefois, il apparaît que les filiales roumaines - dont l’objet est le développement, en Roumanie, de centrales de production d’électricité éolienne - n’ont réalisé aucun chiffre d’affaires et ont procédé à des investissements qui, pour la plupart, n’ont pas de rapport avec des projets de parcs éoliens.
Dans ce contexte, ni le Tribunal administratif, ni la cour administrative d’appel ne souscrivent à la démonstration de la société et concluent ainsi au fait qu’elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les avantages consentis aux filiales roumaines du fait de la non-perception d’intérêts ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
Reste donc la question du quantum des intérêts non perçus et donc du taux d’intérêt retenu par l’administration fiscale pour établir ses redressements.
2. Concernant le taux d’intérêt appliqué par l’administration fiscale
En second lieu, la société a cherché à remettre en cause le taux d’intérêt appliqué par l’administration fiscale pour déterminer le montant des intérêts non perçus sur la période en litige qui, pour mémoire, est conforme au coût de financement supporté par la société au titre des sommes qu’elle a empruntées pour financer les avances accordées aux filiales roumaines.
Pour ce faire, la société se prévaut notamment du taux de rendement des SICAV monétaires ou des parts de fond communs de placement monétaire retenus dans plusieurs décisions du Conseil d’Etat pour établir la rémunération d’avances, assimilables à des dépôts à vue, consenties sans intérêt (cf. décisions Sté Jean-Marc Brocard et Sté Domaine Sainte-Claire de 2009 - CE, 10e et 9e ss-sect., 31 juillet 2009, n° 301935 et 301936, inédites, RJF 12/09 n° 1057) ainsi que du taux moyen d’intérêt des avances sur titres pratiqué par la Banque de France mentionné par la doctrine administrative.
Alors que le Tribunal administratif rejette l’application de ces taux alternatifs au motif que la société s’est endettée dans le seul but de prêter les sommes correspondantes aux filiales roumaines, la cour administrative d’appel procède à une distinction en considérant que les avances consenties aux filiales roumaines sur la base de fonds empruntés devaient faire l’objet d’une rémunération différente de celles accordées sur la base de fonds propres.
En ce sens, la cour administrative d’appel précise : « si le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit en principe être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent, il n’en va pas de même lorsque le prêteur ne dispose pas préalablement des fonds prêtés mais les a lui-même empruntés. Dans ce dernier cas, l’avantage auquel renonce l’opérateur peut valablement être déterminé par rapport aux intérêts qu’il verse à l’organisme qui lui prête les fonds mis gratuitement à la disposition de l’entreprise bénéficiaire ».
De ce fait, selon la cour administrative d’appel, la quote-part des prêts consentis aux filiales roumaines que la société a financé sur fonds propres ne doit pas être rémunérée par référence aux coûts de financement de la société mais en application du taux moyen d’intérêt des avances sur titres pratiqué par la Banque de France tel que revendiqué par la société en première instance.
Cette solution n’est pas sans rappeler celle applicable aux prêts et avances consenties entre membres d’un même groupe d’intégration fiscale qui ont la possibilité de fixer le taux d’intérêt (i) entre le taux de marché et le taux se rapportant aux sommes empruntées par la société prêteuse pour financer le prêt (c’est-à-dire au prix de revient de la prestation de prêt), ou, en cas de financement par fonds propres, (ii) « d’après la rémunération que cette entreprise prêteuse pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel elle placerait les sommes ; en pratique cette rémunération est déterminée d’après le taux Euribor 3 mois communiqué par la Banque de France » (BOI-IS-GPE-20-20-40, §290).
Toutefois, le Conseil d’Etat sanctionne le raisonnement de la cour administrative d’appel pour erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en précisant qu’il
appartient au contribuable de démontrer que le taux d'intérêt qu'entend retenir l'administration fiscale pour déterminer le montant des intérêts non perçus excède le taux d'intérêt que les filiales roumaines auraient pu obtenir d'un prêteur indépendant dans les conditions du marché.
Autrement dit, il revenait à la société de prouver le caractère exagéré des taux d’intérêt retenus par l’administration fiscale sur la période en litige par rapport au taux de pleine concurrence qui aurait été appliqué aux filiales roumaines dans des circonstances comparables.
3. Conclusion
D’un point de vue prix de transfert, la décision du Conseil d’Etat permet de rappeler la dialectique de la charge de la preuve en cas de contestation du taux d’intérêt retenu qui, au même titre que pour l’acte anormal de gestion, procède en deux temps. Dans un premier temps, l’administration fiscale porte la charge initiale en constatant une présomption de transfert (à savoir, au cas présent, une avance sans intérêts) et en indiquant comment elle a déterminé le niveau de taux d’intérêt qu’elle entend retenir (au cas présent, le coût de financement de la société eu égard aux sommes qu’elle avait elle-même empruntées pour financer les avances intragroupe). Dans un second temps, il revient à la requérante d’établir que ce taux serait excessif au regard des caractéristiques des avances et, en particulier, du profil de risque des filiales emprunteuses.
Au demeurant, le raisonnement du Conseil d’Etat introduit également une spécificité liée à la pratique des prix de transfert. Plus précisément, et comme souligné par les conclusions du rapporteur public, alors qu’en matière d’acte anormal de gestion, le raisonnement retenu consiste à faire valoir que « la gestion normale pour un prêteur consiste à ne pas réclamer un intérêt inférieur à ce qu’il pourrait obtenir sur le marché bancaire, et qu’il serait déraisonnable d’exiger d’une société commerciale qu’elle réalise dans ses opérations de prêt des performances comparables à celles d’un banquier », en matière de prix de transfert, il convient d’apprécier le taux d’intérêt applicable au regard du principe de pleine concurrence en recherchant le taux que l’emprunteur aurait pu obtenir d’un prêteur indépendant. Cette différentiation impose donc de traiter avec attention les avances consenties à des entités liées étrangères au risque de voir, en cas d’absence de rémunération, l’administration fiscale déterminer le taux applicable en toute autonomie sur la base de caractéristiques d’emprunt qu’elle aura elle-même définies au regard des circonstances de fait.
Article publié dans Option finance le 4 février 2025