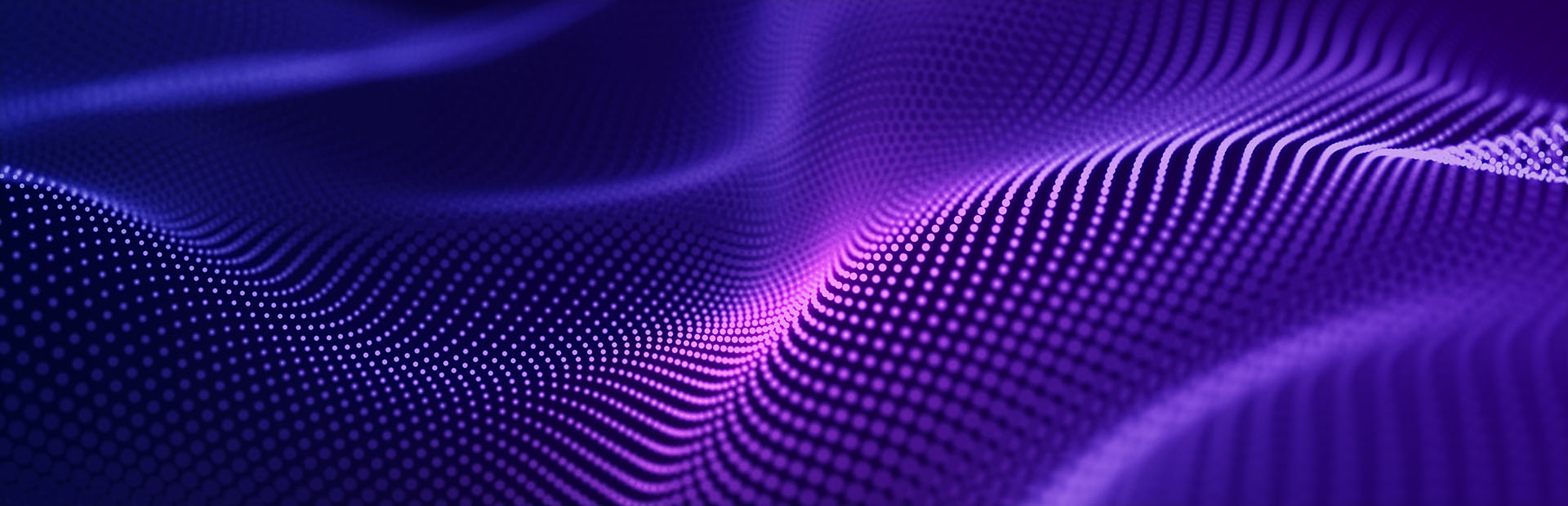Le contribuable face aux lois de validation : un nouveau renfort pour David et Goliath

La pratique des lois de validation pose de plus en plus souvent problème et les contestations s'élèvent. Le jugement du TA de Paris du 11 décembre 2006 (n° 1149 et 1155) en atteste.
En présence d'une loi de validation rétroactive par laquelle le législateur intervient dans un procès en cours, l'équité du procès est mise à mal et le justiciable voit l'égalité des armes rompue à son désavantage.
Dans cette hypothèse, il peut avoir recours à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, qui prévoit le droit à un procès équitable. La position de la Cour européenne des droits de l'homme à cet égard est constante : si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la convention s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige.
Ainsi, si les lois de validation ne sont pas en tant que telles interdites, elles ne sont admissibles que si elles poursuivent un but considéré comme légitime et si elles sont proportionnées à ce but. La France a ainsi, à plusieurs reprises, été condamnée par la Cour de Strasbourg pour avoir adopté des lois de validation venant rompre de façon abusive l'égalité des armes dans le cours d'un procès.
Toutefois, l'article 6 relatif au droit à un procès équitable n'est applicable qu'en matière civile ou pénale et le contribuable sait que, sauf à l'encontre des pénalités assimilées à des sanctions pénales, il ne peut l'invoquer.
L'article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne, qui garantit le droit au respect des biens, est de plus en plus utilisé en matière fiscale, avec succès (voir récemment CEDH, 25 janvier 2007, Aon Conseil et courtage S.A. et autre c/ France).
Cette jurisprudence parviendrait-elle à franchir la porte des juridictions françaises ? Elle a en tout cas franchi celle du TA de Paris.
L'affaire ayant donné lieu au jugement du 11 décembre 2006 concerne la question, bien connue, de savoir qui, du propriétaire ou du sous-traitant, doit supporter la charge de la taxe professionnelle sur les équipements lorsqu'un industriel les confie gratuitement à des sous-traitants pour l'exécution des commandes qu'il leur passe. La doctrine administrative avait de longue date (1979) conclu à l'assujettissement du propriétaire, position qu'un certain nombre d'entreprises ont contestée, avec succès puisque le Conseil d'Etat a tranché en faveur de leur thèse par un arrêt de principe du 19 avril 2000 auquel ont fait suite plusieurs décisions dans le même sens datées du 25 avril 2003. L'Administration a néanmoins confirmé sa position dans une réponse ministérielle du 10 mars 2003 et a suscité le vote de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, introduisant un 3° bis dans l'article 1469 du code général des impôts qui vient valider rétroactivement sa doctrine. A noter d'emblée que cette loi du 30 décembre 2003 a été examinée par le Conseil Constitutionnel, qui, non saisi de la constitutionnalité de cette disposition précise, a implicitement - mais nécessairement - considéré cette disposition de validation rétroactive comme conforme à la Constitution (cf. Décision du 29 décembre 2003, N° 2003-488 DC).
La société requérante, qui s'était taxée en 1996 et en 1997 sur la valeur d'outillages qu'elle avait confiés à des sous-traitants, a demandé la restitution de l'impôt versé en trop et, suite au refus de l'Administration, a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 26 janvier 2000 d'une requête tendant à la réformation de cette décision. Au moment où elle a été déposée, cette requête était totalement fondée puisque quelques mois plus tard le Conseil d'Etat reconnaissait la légitimité de la position soutenue en faveur d'un autre contribuable placé dans la même situation. Mais au moment de statuer, fin 2006, le Tribunal administratif ne pouvait pas faire abstraction de la disposition législative venue dans l'intervalle paralyser les effets de la jurisprudence favorable.
L'argument tiré de l'article 6 n'étant pas invocable en matière fiscale, c'est l'article 1er du Protocole n° 1 que la requérante a invoqué. Cette disposition prévoit que : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes».
Le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cet argument, selon un raisonnement tout à fait conforme à celui de la Cour européenne de Strasbourg.
Il a ainsi considéré que, avant la loi de validation en cause, la créance de la requérante sur l'Etat existait bel et bien. En effet, eu égard aux principes que posait la loi fiscale, telle qu'interprétée par la jurisprudence administrative, conduisant à la non prise en compte dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des biens mis gratuitement à la disposition de ses sous-traitants, la société requérante pouvait se prévaloir à la date de l'adoption de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 d'un droit à obtenir la décharge qu'elle sollicite. Sa créance, compte tenu de la certitude avec laquelle elle pouvait s'attendre à voir sa demande contentieuse satisfaite, présente le caractère d'un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.
La loi de validation est donc clairement venue porter atteinte à ce "bien", ce qui n'est possible qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier.
Pour justifier l'adoption des nouvelles dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, l'administration a invoqué la nécessité de clarifier la situation des sous-traitants industriels compte tenu de ce que le texte de cet article était silencieux sur les immobilisations corporelles qui sont mises gratuitement à la disposition d'une entreprise par une autre. Toutefois ni la volonté de confirmer l'interprétation de la loi fiscale retenue sur ce point par la doctrine administrative depuis 1979, ni le souci de protéger le secteur de la sous-traitance ne peuvent être regardés comme des motifs d'intérêt général justifiant l'application rétroactive de ces nouvelles dispositions.
Si l'Administration a fait également valoir qu'il était nécessaire de prévenir un transfert de recettes fiscales au détriment des grandes agglomérations où sont situés les donneurs d'ordres vers les villes moyennes où sont implantés les sous-traitants, elle n'a apporté aucun élément permettant d'apprécier dans quelle mesure l'application des nouvelles dispositions aux impositions antérieures était de nature à servir cet objectif de maintien du statu quo, dont elle ne justifie pas davantage, au surplus, qu'il répondait à un motif d'intérêt général.
L'Administration a fait valoir également que le législateur a notamment souhaité, s'agissant des impositions relatives aux années antérieures à l'année 2004, éviter que certains biens n'échappent à l'impôt dans la mesure où, d'une part, les donneurs d'ordres pouvaient se prévaloir de la jurisprudence administrative et où, d'autre part, les sous-traitants pouvaient invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, la doctrine administrative qui interprétait la loi fiscale comme écartant leur imposition au profit de celle des propriétaires. Cette situation pouvait, il est vrai, avoir pour conséquence que certaines immobilisations ou biens d'équipements ne soient plus inclus dans la base imposable à la taxe professionnelle pour des motifs tirés uniquement de leurs modalités d'exploitation et entraîner une perte pour le budget des collectivités territoriales que l'Administration évalue, dans sa défense, à au moins cent dix millions d'euros.
Toutefois, le Tribunal considère que ce risque budgétaire résulte de l'interprétation erronée que la doctrine a continué de donner de la loi fiscale jusqu'à l'adoption de la loi du 30 décembre 2003. En voulant faire supporter aux donneurs d'ordres les conséquences financières de l'erreur qu'a ainsi commise l'Administration en les désignant comme étant les redevables légaux de l'impôt, la loi de validation en cause porte une atteinte disproportionnée aux droits qu'ils tenaient de la loi alors en vigueur de ne pas être imposés sur les biens remis gratuitement à leurs sous-traitants.
La société requérante était par suite fondée à soutenir que la loi de validation méconnaît les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne, ce qui justifie que lui soit accordée la décharge demandée.
Il est intéressant de constater que cette décision confirme qu'une loi de validation rétroactive est susceptible, même en matière fiscale, d'être condamnée pour violation de la Convention européenne, ce alors même que cette loi avait été validée par le Conseil Constitutionnel lui-même. Ce n'est pas nouveau puisque tel était déjà le cas dans l'arrêt Zielinsky (CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Zielinsky & Pradal et Gonzalez et autres c/ France), à ceci près que la condamnation émanait de la Cour de Strasbourg.
Tout porte à penser que ce jugement fera date car il suit scrupuleusement la démarche qu'adopte la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts. Reste toutefois à attendre l'issue de l'appel interjeté par l'Administration.
La voie qui s'ouvre ne manquera pas dans l'intervalle d'être explorée par les contribuables contre d'autres validations décidées dernièrement, que ce soit dans le domaine de la taxe professionnelle, pour rehausser le plancher d'évaluation des immobilisations transférées par fusion entre sociétés liées, ou dans le domaine de la détermination du résultat fiscal, pour rétablir la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à vérification, qu'avait condamnée le Conseil d'Etat.
Article paru dans la revue Option Finance du 11 juin 2007
Authors:
Laurent Chatel, Avocat Associé - Olivia Davidson, Avocat